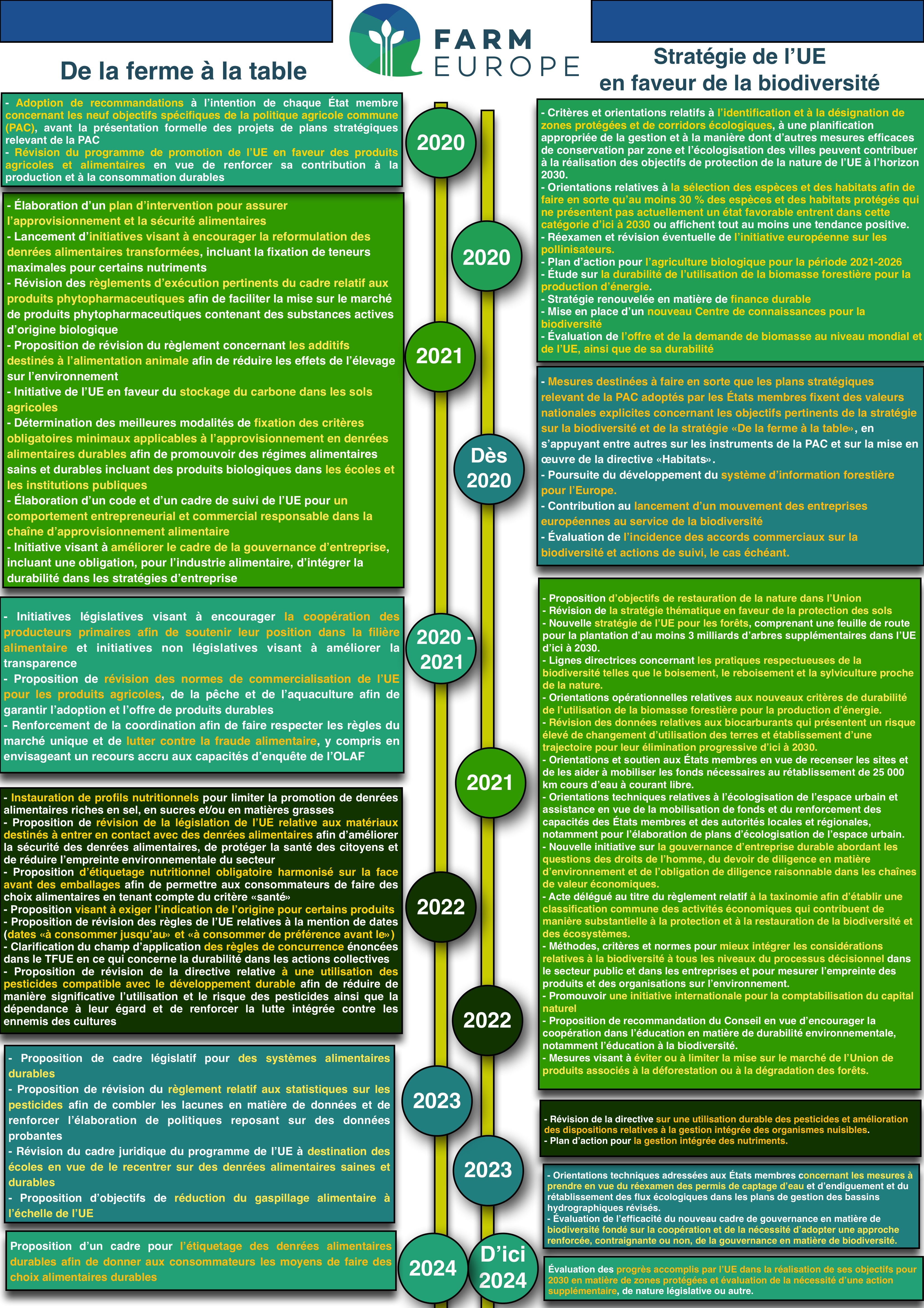Archives : Travaux
Post Type Description
Stratégie Européenne pour lutter contre le cancer
3 février, 2021
La Commission européenne est sur le point de publier sa stratégie pour vaincre le cancer. Le document vise à donner une orientation politique de l’action de l’UE dans la lutte contre le cancer. Il prend en considération les différentes phases des maladies, ainsi que l’environnement du patient (les survivants, les soignants, leur famille, etc.). Il s’agit d’un pas dans la bonne direction en matière de prévention des cancers et, espérons-le, d’amélioration des traitements et des connaissances.
Néanmoins, certains points sont à souligner :
– Prévention : la stratégie souligne à juste titre que « la prévention est le plus efficace de tous les traitements » et qu’il s’agit de « la stratégie de lutte contre le cancer à long terme la plus rentable ». La commission souhaite proposer donc un plan qui « sensibilisera sur les principaux facteurs de risque tels que les cancers dus à des modes de vie malsains ». « Le plan européen de lutte contre le cancer donnera aux individus les informations et les outils dont ils ont besoin pour faire des choix plus sains », mais aucune action concrète n’est proposée. Or, la stratégie ne doit pas oublier que l’éducation est l’élément clé de toute vision à long terme.
– Comme dans la proposition de programme européen pour la santé « EU4Health » (2021-2027), le plan évoque l’alimentation et de la nutrition en tant que causes de cancer. Néanmoins, une approche plus complète serait nécessaire afin de reconsidérer le rôle que les régimes alimentaires jouent dans la santé. Les politiques européennes et nationales doivent en effet investiguer les effets de notre alimentation sur la santé, en se basant sur des démarches scientifiques et sans ostracisme simpliste, mais en diffusant les connaissances scientifiques et en impliquant activement les citoyens.
– L’approche de la Commission va dans la bonne direction lorsqu’elle traite de l’obésité chez les enfants. Toutefois, une simple relance des politiques et actions existantes qui n’ont pas donné les résultats attendus (comme les programmes scolaires actuels de distribution de fruits et légumes, parce qu’occasionnels et axés sur un petit nombre d’écoles et d’enfants) ne suffira pas. L’école est effectivement le lieu où peuvent se former des habitudes saines ; dans ce contexte, des programmes scolaires obligatoires axés sur la santé et les modes de vie pourraient être une solution plus appropriée, et concrétiseraient l’objectif avancé par la commission (« les mesures prises dans les écoles porteront également sur l’éducation à la santé afin d’améliorer les connaissances sur les avantages d’une alimentation saine »).
– En ce qui concerne la proposition d’action visant à mettre en œuvre des mesures d’incitation/dissuasion fiscales en matière d’alimentation, des études [1, 2, 3] ont montré la moindre efficacité de ce type de politiques, ainsi que le risque de disparités sociales sous-jacentes. En ce qui concerne cette action, la Commission devrait procéder à une évaluation d’impact approfondie et présenter des propositions efficaces axées sur l’éducation, l’information et le traitement de la question de la santé liée aux denrées alimentaires commercialisées, notamment les denrées alimentaires transformées et ultra- transformées.
—
REFERENCES :
- Darmon et al. “Food price policies improve diet quality while increasing socioeconomic inequalities in nutrition” International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2014, 11:66. Online source, consulted on October 22nd, 2020: http://www.ijbnpa.org/content/11/1/66
- Eyles et al., “Food pricings strategies, population diets, and non-communicable disease: a systematic review of simulation studies”, PLoS Medicine, 2012. Online source, consulted on November 4th 2020: https://www.researchgate.net/publication/233915556
- Smed et al., « Differentiated food taxes as a tool in health and nutrition policy”, Food and resource economics institute, 2005.
EAT EUROPE est le département dédié de Farm Europe qui vise à aborder les questions sociétales les plus sensibles, en se concentrant sur le rôle que les acteurs institutionnels jouent dans la santé publique, en analysant et en définissant les outils que l’UE et ses États membres pourraient mettre en œuvre afin de prévenir leur population des habitudes qui pourraient conduire à des modes de vie malsains. Eat Europe raisonne sur la science et l’efficacité, en rassemblant les connaissances des gens et en se concentrant exclusivement sur le bien commun de l’UE et sa capacité de mettre en oeuvre.
NÉGOCIATION POUR LA RÉFORME DE LA PAC : Conseils de la Commission pour les éco-régimes
En janvier, la présidence portugaise du Conseil de l’UE a débuté. La ministre de l’agriculture, do Cèu Antunes, a défini les priorités de son mandat : conclure les négociations de la PAC avec le Parlement, dans l’espoir de renforcer la résilience du secteur et d’assurer une transition vers une architecture plus verte. Sur ce dernier sujet, la Commission a publié un document décrivant les mesures potentielles que les États membres pourraient inclure dans l’élaboration des éco-régimes, étant donné qu’ils ont déjà commencé à travailler sur leurs plans stratégiques nationaux (à soumettre à la Commission d’ici la fin 2021). La ministre allemande de l’agriculture a entamé une consultation interne avec les représentants des Länder. En ce qui concerne la discussion sur le règlement horizontal, la réserve pour le soutien de la PAC en cas de crise semble être un sujet difficile à surmonter pour les négociateurs.
note complète disponible sur l’espace Membres de FE
QUE CONTIENT L’ACCORD FINAL DU BREXIT POUR L’AGRICULTURE EUROPÉENNE
Les négociations d’un accord commercial post-Brexit avec le Royaume-Uni ont finalement été conclues à la dernière minute, après des années de hauts et de bas. Dès le début, Farm Europe a analysé de près les conséquences du Brexit et a attiré l’attention du secteur et des décideurs sur son impact.
Notre évaluation est claire : l’accord conclu apparaît comme le meilleur résultat possible, même si le meilleur aurait été de ne pas avoir de Brexit.
L’accord commercial prévoit un commerce en franchise de droits et de contingents pour les produits agricoles. L’Union européenne enregistrant un excédent commercial considérable avec le Royaume-Uni, c’est un résultat positif.
En ce qui concerne les règles sanitaires et phytosanitaires, chaque partie doit respecter les règles de l’autre lorsqu’elle exporte.
En ce qui concerne les produits biologiques, un accord d’équivalence a été conclu.
Sur la question très technique, mais tout aussi importante, des règles d’origine, essentielles pour empêcher le « commerce triangulaire » afin que le Royaume-Uni ne devienne pas une plate-forme d’exportation de produits de pays tiers vers l’UE, la plupart des produits sont couverts par la règle « entièrement obtenus ». Cela signifie que les produits exportés du Royaume-Uni et qui bénéficient d’un accès en franchise de droits à l’UE, doivent être fabriqués au Royaume-Uni sans aucun contenu significatif provenant de pays tiers. Les viandes, les produits laitiers, les céréales, l’amidon, les vins, sont bien couverts par cette règle. En ce qui concerne les produits transformés, la teneur en sucre a dans certains cas une plus grande marge de manœuvre, tant que le Royaume-Uni maintient une protection élevée aux frontières, les problèmes importants devraient être évités.
L’intégrité du marché unique de l’UE est donc préservée.
Le seul domaine où un accord ne semble pas avoir été atteint est celui de la reconnaissance des indications géographiques, bien qu’il y ait quelques formulations concernant d’éventuelles discussions supplémentaires, qui doivent être encouragées.
Pour conclure, il a tout lieu de saluer le travail de la Commission, en particulier le négociateur en chef Michel Barnier et son équipe.
Mais n’oublions pas que Brexit, même avec un bon accord commercial, entraînera une augmentation des coûts et de la bureaucratie liés aux procédures douanières ; et une concurrence accrue sur le marché britannique pour nos exportations, le Royaume-Uni ayant la liberté de négocier des accords commerciaux avec des pays tiers. En outre, le risque de divergence réglementaire à l’avenir est réel, il fonctionne dans les deux sens et pourrait avoir un impact négatif sur le libre-échange.
L’impact réel du Brexit sur notre balance commerciale agricole avec le Royaume-Uni ne se fera sentir que dans quelques années, à mesure que le Royaume-Uni s’ouvrira progressivement à des pays tiers hautement compétitifs.
Bien que l’accord commercial soit le meilleur possible, notre secteur agroalimentaire ne devrait pas perdre de temps à se préparer à une concurrence accrue. Les ressources de la PAC devraient être mobilisées sans délai pour soutenir l’amélioration de la productivité économique de l’agriculture, tout en améliorant ses références environnementales.
Mobiliser le fond de relance européen agricole pour une transition accélérée vers une agriculture européenne de double performance
L’agriculture de précision permet de proposer aux agriculteurs et aux éleveurs des solutions adaptées à leur contexte. Les données issues de capteurs, de caméras, de satellites, de stations météorologiques sont traitées par des algorithmes qui procurent par le biais d’Outils d’Aide à la Décision (OAD) des conseils quant aux actions les plus pertinentes pouvant être réalisées.
L’utilisation de ces outils assure au niveau de l’exploitation une meilleure efficience des intrants. Ces derniers sont ajustés aux besoins quantifiés des cultures et des animaux tout en assurant l’optimisation des rendements. Ils constituent un outil crucial d’une transition de l’agriculture européenne vers une agriculture de double performance : plus économe en intrants et prenant soin de l’environnement, plus efficiente économiquement.
L’agriculture digitale a aussi le potentiel de simplifier le fardeau administratif, tant au niveau de la mise en œuvre et du contrôle des mesures de la PAC, qu’au niveau des données entrées par les agriculteurs.
Si les études mettent en exergue les bénéfices de tels outils, le passage du stade « recherche » à la sphère agricole se fait encore lentement. A ce jour, l’agriculture digitale reste peu démocratisée.
A cela s’ajoutent d’autres principaux freins : le coût de ces technologies, la crainte que de tels investissements de long terme ne deviennent rapidement obsolètes.
Or, au regard de leurs avantages économiques, sociaux et environnementaux, il serait urgent de généraliser au sein de l’Union Européenne l’utilisation des outils liés à l’agriculture de précision en production végétale ainsi que l’utilisation de capteurs et de robots en élevage.
L’Union Européenne doit être acteur de la démocratisation de ces outils, les rendant accessibles à tous les agriculteurs et éleveurs quel que soit le type et la taille des exploitations agricoles, leur pratiques agricoles, leurs formations.
Mobiliser 60% du plan de relance pour soutenir les investissements innovants de précision en agriculture en 2021 et 2022 permettra un plan choc de 10 milliards d’investissements pour une transition accélérée de l’agriculture européenne vers la double performance. Les investissements de ce plan pourraient être soutenus à hauteur de 53% (part EU fond de relance 90%, 10% contrepartie Etat membre), mobilisant 4,8 milliards des 8 milliards du dit plan de relance.
Les 3 milliards complémentaires de ce fond de relance devraient être affectés, en synergie, aux actions d’acquisition de compétence et de promotion des produits européens.
***
Quelles incitations pour une transition accelérée ?
Alors que 8 milliards € viendront abonder les financements du 2nd pilier de la PAC au titre de la relance des filières agricoles, relance à opérer en cohérence avec les objecifs Green Deal, il conviendrait d’utiliser ces fonds de façon ciblée, pour préparer réellement l’avenir et le rebond des filières agicoles europénnes.
Cela implique de financer prioritaiement les investissements de transition de double performances, ainsi que des mesures pour accroître la compétence des agriculteurs en matière de techniques innovantes, pour renforcer la structuration des filières et la promotion des produits européens.
Dés lors, l’objectif serait de consacrer au moins 5 milliards d’euros de cette dotation au soutien aux investissements de l’agriculture de précision au cours des années 2021 et 2022, en complément des mesures « investissements » qui seront mis en œuvre dans le cadre de la PAC réformée à compter de 2023 (et celles poursuivies durant la période de transition). Ces 5 milliards d’euros constitueraient une incitation décisive d’un plan choc de 10 milliards € d’investissements afin de répendre largement l’usage des OAD sur l’ensemble des surfaces agricoles européennes et accélérer l’accessibilité des outils digitaux aux élevages.
Cette mutation sera porteuse d’économies substantielles d’intrants, gages d’une plus forte durabilité et rentabilité des productions européennes, réponse opérationnelle :
– aux attentes des citoyens sur l’environnement, la qualité des aliments…
– aux attentes des citoyens sur l’environnement, la qualité des aliments…
– et aux impératifs de compétitivité en matière de coûts mais aussi de valorisation de démarches de qualité.
Ces investissements devront être raisonnés de différentes façons pour s’adapter à la diversité des exploitations. Si les exploitations au-delà d’une certaine taille peuvent réaliser les investissements seules, il sera aussi opportun de favoriser des investissements collectifs dans d’autres cas de figures, et notamment dans les régions au sein desquelles les exploitations peuvent être de plus petites tailles. Des investissements dans le cadre de coopératives, des CUMA ou d’un organisme porteur tiers, comme le fait GAIA en Grèce, doivent trouver toute leur place dés lors qu’ils s’avèrent porteurs d’efficacité. Le financement de la coordination entre les producteurs, ainsi que de l’appui technique et la maintenance des équipements peut et doit ëtre réalisé par les coopératives. La traçabilité des produits finaux et des traitements qui leurs sont apportés devra également être assurée par ces dernières.
Productions végétales :
Les outils digitaux liés à la production végétale peuvent être classés en 5 niveaux selon leur degré de précision, le matériel nécessaire et leur coût. L’utilisation d’outils d’agriculture de précision (capteurs, stations météo, images satellites, caméras, OAD de gestion d’intrants) sont présents à chaque niveau. Les stations météo demandent un investissement compris entre 400 € et 2 000 € (Weenat, 2020). Certains OAD sont gratuits. Ceux qui prescrivent les quantités d’intrants à épandre à partir de capteurs et d’images satellites des cultures ont un coût maximum de 20 €/ha/an (Farm Europe, 2019).
– Le premier niveau, le plus accessible, consiste à utiliser les informations données par ces outils pour ajuster les applications à l’échelle d’ensemble de parcelles présentant les mêmes conditions pédoclimatiques et risques phytosanitaires. Le second niveau consiste à ajuster les intrants à l’échelle de la parcelle.
– A partir du troisième niveau, en grandes cultures, ces outils sont associés aux outils de modulation des doses. Il s’agit entre autres des pulvérisateurs de précision qui ont un coût plus conséquent. Les plus accessibles coûtent environ 3 000 € et sont raccordés à un service de cartographie des besoins. Les pulvérisateurs modulant les doses à partir des données issues de caméras embarquées peuvent coûter plus de 40 000 €. La modulation des doses d’azote assure une économie d’engrais variant entre 4 et 47% selon les productions et les environnements tout en maintenant ou augmentant le rendement jusqu’à 10%. Le financement d’un tel pulvérisateur peut avoir lieu sur 5 à 10 ans. Une économie de 11 à 90% est constatée, selon les cas, concernant les pesticides (herbicides, fongicides et insecticides). Une augmentation de la marge brute allant de 7 à 38€/ha/an est possible.
La direction assistée et les systèmes de gestion d’une circulation raisonnée complètent ce niveau, élevant la précision des actions réalisées. Ces technologies permettent d’éviter de croiser les trajectoires lors des traitements et de gagner en précision à l’échelle intra- parcellaire. Leur coût varie de 1 300 € environ si le tracteur est déjà équipé de GPS et peut aller jusqu’à 50 000 € pour ceux contenant le plus d’options. La direction assistée permet une économie de 2% des semences et engrais, de 6,32 à 10% de carburant et de 6,04% de main d’œuvre. Elle permet d’augmenter la marge brute entre 38 et 612€/ha/an. La circulation raisonnée complète la direction assistée avec l’analyse des données des itinéraires et des traitements issus des années précédentes. Elle permet une économie de 3 à 15% d’engrais, 25% de pesticides, de 25 à 70% de carburant et de 70% de la main d’œuvre. Une augmentation de 15% du rendement a aussi pu être observée. Des augmentations de 40 à 80% de l’efficience de l’azote ont été évaluées, permettant d’augmenter la marge brute de 57 à 115€/ha/an (Balafoutis et al., 2017).
– Les niveaux 4 et 5 additionnent aux outils des niveaux précédents la robotisation comme alternative aux pesticides pour la gestion des bio-agresseurs (adventices, maladies et ravageurs) ainsi qu’une irrigation de précision. Le but de la robotisation est qu’il n’y ait plus de résidus de fertilisation et de pesticides détectables. L’ajustement des intrants a lieu à l’échelle intra-parcellaire pour le niveau 4 et à l’échelle de la plante pour le niveau 5. Les robots désherbeurs coûtent entre 25000€ et 80000€. Ils permettent de réduire les quantités de pesticides de 20 fois par rapport à une protection standard. Ils réduisent également l’utilisation de carburant ainsi que le temps de travail.
L’irrigation de précision permet d’ajuster les quantités d’eau irriguées aux besoins des cultures, à l’humidité du sol et aux prévisions météo. Les systèmes les plus aboutis peuvent déclencher automatiquement l’irrigation si ces paramètres sont sous un certain seuil. Les contrôleurs de débit des systèmes d’irrigation pivot sont les plus accessibles à partir de 1 300 € et les systèmes de gestion de l’irrigation par contrôle du pivot peuvent coûter jusqu’à 35 000 €. L’irrigation goutte à goutte coûte environ 40€/ha. Une économie allant jusqu’à 34% est observée selon les systèmes d’irrigation. Leur effet sur le rendement est plus contrasté allant d’une réduction de 18% à une augmentation de 31%. L’efficience des intrants varie donc de -12% à 97% pour les systèmes contrôlant les pivots. Une économie d’eau d’environ 30€/ha/an a été constatée au Royaume Uni (Balafoutis et al., 2017). C’est
autour de la méditerranée que l’irrigation de précision a le plus grand potentiel. La consommation d’eau et d’énergie est réduite de 10 à 14% en moyenne (FIGARO Irrigation Platform, 2016). En Grèce, le bénéfice net peut aller jusqu’à 480€/ha pour une culture de coton (Balafoutis et al., 2017).
Élevage :
L’élevage de précision s’appuie sur l’utilisation de capteurs et de robots.
Les capteurs peuvent être sur les animaux pour surveiller leur santé (troubles métaboliques, infectieux, boiteries, mamelles, chaleurs, gestations et vêlages). Des GPS permettent de surveiller la localisation des animaux. Ces contrôles peuvent se faire grâce à des colliers qui coûtent environ 120€ l’unité, auxquels s’ajoutent 4 000€ pour le stockage et l’interprétation des données et 180€ de frais annuels. Ces capteurs embarqués permettent d’économiser jusqu’à 100€ par vache, de gagner jusque 30% de productivité et jusqu’à une heure de travail par jour (IDELE, 2019; LITUUS, 2019). Le stockage et la qualité des aliments peuvent également être évalués, tout comme la composition du lait. Les analyses de lait permettent d’anticiper les infections, chaleurs… Un éleveur va détecter 50 à 55% des chaleurs tandis qu’un détecteur automatisé en détectera 50 à 99%. L’anticipation liée à ces analyses permettent un gain de 2 000 € environ (Huneau & Gohier, 2017).
La robotisation permet de simplifier la traite, le nettoyage des étables ou la distribution de la paille et l’alimentation (mélange, quantité d’aliments distribuées, nombre et heure de passage et raclage des refus). Un robot d’alimentation, préparant les mélanges et distribuant les rations coûte environ 230 000 € pour 150 vaches laitières. Ce type de robot peut être financé durant 12 ans et amorti en 15 ans. Le coût annuel d’investissement est entre 25 et 44% supérieur à celui d’un tracteur et d’une mélangeuse, une économie d’environ 50% des frais d’entretien et des charges a lieu par rapport à ces derniers. De même une réduction de 15 à 20% de la main d’œuvre est observée. Au final, certaines études pointent une économie de près de 60% annuellement par rapport à l’utilisation d’un tracteur et d’une mélangeuse. D’autres études estiment qu’il y a une augmentation du coût de production de 6 097€/an mais une économie de 400h de travail (Autellet, 2019).
Un robot de traite coûte environ 120 000 € pour 80 vaches. Bien qu’ils réduisent le temps de travail, les robots de traite augmentent la consommation de concentré, et donc les coûts liés à l’alimentation. Une augmentation du nombre de cellules somatiques, réduisant la qualité du lait peut avoir lieu. Associé au coût de l’investissement et de l’installation des robots cela réduit la rémunération final pour 1 000 litres de 70€ à 48€. Cette perte est compensée par une augmentation moyenne de 11% du volume de lait par vache et par an (Autellet, 2019; Cogedis, 2019).
Acquisition des compétences :
Quel que soit l’outil et son coût, des formations sont nécessaires. Leurs coûts varient entre 420 et 1 400€ (Idele, 2020).
Liste des références :
Autellet, R. (2019). Robotisation en élevage : état des lieux et évolution. Académie de l’Agriculture de France.
Balafoutis, A., Beck, B., Fountas, S., Vangeyte, J., & Wal, T. van der. (2017). Precision Agriculture Technologies Positively Contributing to GHG Emissions Mitigation, Farm Productivity and Economics. Sustainability, 9(1339), 28.
Cogedis. (2019). Le passage en traite robotisée s’accompagne d’une augmentation de la productivité. Plein Champ.
Farm Europe. (2019). Etude des performances économiques et environnementales de l’agriculture digitale.
FIGARO Irrigation Platform. (2016). FIGARO’s Precision Irrigation Platform Presents Major Water and Energy Savings. http://www.figaro-irrigation.net/outputs/the-figaro- platform/en/
Huneau, T., & Gohier, C. (2017). Agriculture de précision robotique et données. In Fermes numériques (Vol. 1, Issue). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Idele. (2020). Idele formation.
IDELE. (2019). Inventaire et tests de capteurs.
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/inventaire-et-
tests-de-capteurs.html
LITUUS. (2019). Monitoring des bovin au service de la performance.
Soto, I., Barnes, A., Balafoutis, A., Beck, B., Sánchez, B., Vangeyte, J., Fountas, S., Van der
Wal, T., Eory, V., & Gómez-Barbero, M. (2019). The contribution of precision agriculture technologies to farm productivity and the mitigation of greenhouse gas emissions in the EU. https://doi.org/10.2760/016263
Weenat. (2020). Communication personnelle.
LE PLAN DE RELANCE EUROPÉEN : COMMENT LE CONCEVOIR POUR MIEUX SOUTENIR L’AGRICULTURE
La Commission européenne a présenté un ambitieux plan de relance européen et un nouveau cadre financier pluriannuel pour la période 2021-27.
Les nouvelles propositions prévoient de nouvelles ressources pour le secteur agricole par rapport à la proposition initiale de mai 2018, bien que le montant total du soutien diminue à prix constants de 34 milliards d’euros (valeur 2018) par rapport à la période 2014-2020.
Les éléments clés de ces propositions pour le secteur par rapport à la proposition de 2018 sont les suivants :
– « Un renforcement de 15 milliards d’euros du Fonds européen agricole pour le développement rural afin d’aider les zones rurales à réaliser les changements structurels nécessaires conformément au « Pacte vert » européen et à atteindre les objectifs ambitieux fixés dans le cadre des nouvelles stratégies « biodiversité » et « De la ferme à la table » » dans la situation économique post-Covid.
– « Une augmentation de 4 milliards d’euros pour la politique agricole commune (…), afin de renforcer la résilience du ou des secteurs agroalimentaires (…) et de fournir la marge de manœuvre nécessaire à la gestion des crises ».
Le présent document vise à présenter les propositions de Farm Europe sur la meilleure façon d’utiliser ces ressources indispensables.
– Il est prévu que les ressources supplémentaires pour le développement rural soient engagées entre 2022 et 2024. Il conviendrait de modifier cette disposition pour permettre l’engagement des nouvelles ressources à partir de 2021. Il s’agit d’aider sans retard excessif le secteur à se remettre de la crise actuelle et à se préparer pour l’avenir. Les nouvelles ressources devraient donc faire partie du budget 2021 et ne pas attendre la mise en œuvre de la réforme de la PAC qui n’interviendra pas avant 2023.
– La deuxième proposition est de consacrer le renforcement de 15 milliards d’euros au soutien à des investissements de double performance dans les exploitations agricoles. Ces investissements devraient permettre de réduire l’empreinte écologique tout en améliorant la situation économique des agriculteurs.
Il s’agit notamment d’investissements dans des outils et systèmes agricoles numériques ou de précision, dans la production de bio-méthane à partir des effluents d’élevage… De tels investissements répondent aux objectifs fixés par la Commission pour préparer le secteur à « réaliser les changements structurels nécessaires conformément au pacte vert européen et à atteindre les objectifs ambitieux fixés dans le cadre des nouvelles stratégies « biodiversité » et « de la ferme à la table » ».
– Une autre proposition consiste à renforcer les taux de cofinancement pour ces investissements. La Commission a réduit de 10 % les taux de cofinancement des actions de développement rural dans sa proposition de réforme de la PAC. Mais la situation économique et financière désastreuse de nombreux agriculteurs et pays exige un taux de financement communautaire plus élevé pour garantir une utilisation optimale. Farm Europe propose donc que le cofinancement communautaire soit porté à 75 %.
Ces investissements devraient bénéficier de la majeure partie des nouvelles ressources, et au moins 10 milliards d’euros devraient être affectés à cette fin.
– Les nouvelles ressources devraient également contribuer à soutenir davantage les outils de gestion des crises, tels que l’assurance climatique, les fonds communs de placement et l’assurance-revenu. L’UE, à quelques exceptions près, est mal équipée pour ces outils, et les nouveaux fonds pourraient fournir les incitations nécessaires pour encourager les agriculteurs à utiliser les dispositions législatives existantes. Le principal obstacle au développement d’outils de gestion des crises dans l’UE semble être le coût. Les nouveaux fonds pourraient fournir les ressources nécessaires pour accroître le cofinancement communautaire et rendre ainsi ces outils plus attrayants.
– Les 4 milliards d’euros de nouvelles ressources pour le premier pilier de la PAC sont clairement destinés à la gestion des crises. Cela permettrait de créer enfin une réserve de crise et de la financer de manière adéquate, comme l’a proposé Farm Europe dans des documents et initiatives précédents, et comme l’a proposé la Comagri du Parlement européen. Un montant de 1,5 milliard d’euros devrait être affecté à la nouvelle réserve de crise à partir de 2021. La réserve de crise devrait être dotée du mandat et des ressources nécessaires pour redresser rapidement les marchés, en intervenant à un stade précoce et sans délai avec un large éventail de mesures d’urgence.
– Les ressources restantes devraient être utilisées pour soutenir les secteurs qui souffrent déjà de l’impact du Covid-19. Des actions de soutien devraient être convenues pour rééquilibrer rapidement les marchés durement touchés, par exemple dans les secteurs du vin, de la viande bovine et des viandes ovine et caprine.
Il est d’une importance cruciale de mobiliser rapidement les ressources supplémentaires à partir de 2021. Il serait imprudent et contraire à l’objectif clé du plan de relance européen d’attendre l’adoption de la réforme de la PAC et la présentation ultérieure des plans stratégiques. Ce processus signifierait deux années perdues alors que la crise frappe fort. Farm Europe estime que le plan de relance de la Commission européenne, même s’il ne prévoit toujours pas suffisamment de budget pour le secteur, offre une occasion unique de façonner la réponse à la crise du Covid-19 et de préparer le secteur au Pacte vert européen – à condition qu’il soit bien conçu.
L’UE A BESOIN D’UNE NOUVELLE POLITIQUE COMMERCIALE AGRICOLE
L’impact de la crise du Covid-19 se fait encore sentir, mais une leçon peut déjà être tirée : garantir sa sécurité alimentaire est un impératif pour l’Union Européenne.
Dans certains secteurs stratégiques, le manque de disponibilités intérieures a été assez aigu, mais heureusement, l’agriculture dans l’UE a assuré son rôle fondamental de nourrir nos citoyens.
Au cœur de la crise, de nombreux pays ont eu recours à des interdictions et des restrictions vis à vis de leurs exportations, y compris dans le secteur agroalimentaire. Que se serait-il passé si l’UE avait été aussi vulnérable en matière d’approvisionnement alimentaire que pour certains équipements médicaux ?
Contrairement aux pays qui ont imposé des restrictions à leurs exportations de denrées alimentaires, l’UE a assuré sa part de l’approvisionnement mondial. Ce n’est pas un élément mineur ou secondaire, car la pénurie alimentaire est un risque réel dans de nombreuses régions pauvres du globe, et en premier lieu en Afrique.
Aujourd’hui, le moment est venu de revoir la politique commerciale de l’UE, en particulier dans le domaine de l’agriculture, à la lumière de l’expérience passée et des enseignements de la crise du Covid-19.
De façon synthétique, la politique commerciale actuelle de l’UE pourrait être décrite comme étant disposée à conclure le plus grand nombre possible d’accords de libre-échange (ALE) avec le plus grand nombre de pays possible.
L’hypothèse sous-jacente pour l’UE, et ses partenaires commerciaux, est que bénéficier d’un commerce plus libre accroît la richesse.
L’agriculture fait toujours partie des ALE, comme l’exigent les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
Un autre élément stratégique qui sous-tend la politique commerciale de l’UE est la conviction qu’un commerce plus libre sous l’égide de règles internationales est un élément clé de la mondialisation, et un moyen de réduire les lignes de faille et d’améliorer une approche coopérative des questions planétaires.
Cette approche globale a conduit la Commission européenne (CE) à négliger de procéder à des analyses approfondies de l’impact de chaque ALE, et à ne pas se prononcer sur leurs propres mérites. Les analyses d’impact de la CE s’appuient systématiquement sur des évaluations globales et ignorent les impacts spécifiques dans des secteurs particuliers.
Les conséquences de cette situation ont été particulièrement aigues dans le secteur de l’agriculture.
L’agriculture et la sécurité alimentaire n’ont pas été au premier plan des préoccupations européennes lors des négociations commerciales qu’elle a menées. Certes, il a été reconnu que les secteurs agricoles très vulnérables (généralement le bœuf, le sucre et, dans une certaine mesure, le porc) ne devraient pas être pleinement exposés à une concurrence extérieure sans entraves, mais jamais au point de mettre un terme à l’augmentation constante de l’accès au marché de l’UE ou d’aider ces secteurs sensibles à faire face à une concurrence accrue. De plus, certains secteurs, comme celui de la viande ovine et caprine, ont été largement laissés à eux-mêmes alors que leur situation économique s’est détériorée avec l’augmentation des importations.
Farm Europe estime que le moment est venu d’adopter une politique commerciale plus équilibrée.Après le Covid-19, nous avons besoin d’un changement de politique qui intègre l’imératif de sécurité alimentaire. Nous devons trouver un meilleur équilibre entre les avantages de la libéralisation des échanges et ses effets négatifs asymétriques. Nous avons besoin de moins de politique idéologique et de plus de pragmatisme et de réalisme.
Il ne s’agit pas d’être contre le commerce, ni contre la négociation d’ALE au profit des producteurs et des consommateurs. Les ALE apportent des avantages réels qu’il convient non seulement de préserver mais de faire fructifier.
L’UE est un des principaux exportateurs nets de produits agroalimentaires. En 2019, la valeur des exportations de produits agroalimentaires s’élevait à un total de 151,2 milliards d’euros, tandis que les importations représentaient 119,3 milliards d’euros. L’excédent commercial a atteint un niveau record de 31,9 milliards d’euros. Il est indéniable que le commerce apporte de la richesse et des emplois au secteur.
L’isolement à l’intérieur de nos frontières entraînerait une baisse de la production, des revenus agricoles, des emplois, des agro-industries, un ralentissement du progrès technologique et de l’innovation stimulée par la concurrence internationale.
Sans les exportations agroalimentaires de l’UE, la sécurité alimentaire de nombreux pays, et notamment en Afrique, serait compromise. Alors que la demande de denrées alimentaires augmente, le rôle de l’UE en tant que premier exportateur mondial est primordial.
L’excédent commercial de l’UE sur les produits agroalimentaires masque cependant le fait que l’excédent de l’UE sur les produits agricoles bruts est faible, les chiffres globaux étant largement aidés par les performances de l’UE en matière d’exportation de produits transformés, en particulier de haute valeur.
Les ALE ne doivent pas compromettre la viabilité des secteurs les plus vulnérables. Les ALE ont fait des gagnants et des perdants dans l’agriculture, et les perdants ont été laissés seuls pour faire face aux conséquences.
Bien que les ALE prévoient individuellement de protéger les secteurs les plus sensibles en limitant le libre-échange dans le cadre de quotas, l’accumulation des ALE, entre autres facteurs, entraîne une détérioration de la situtation des secteurs vulnérables comme la viande bovine, ovine et caprine.
Une nouvelle politique commerciale devrait rechercher les avantages de la libéralisation des échanges tout en protégeant complètement les secteurs agricoles vulnérables ou en adoptant des programmes spécifiques pour aider ces secteurs à faire face à la situation (et fournir des ressources communautaires obligatoires pour financer ces programmes).
La CE devrait, dans son évaluation préalable à l’engagement de négociations d’ALE, évaluer soigneusement le degré d’ouverture des frontières dans les secteurs clés et intégrer dans son évaluation, le cas échéant, la conception et les ressources nécessaires pour aider ces secteurs à faire face à une concurrence extérieure supplémentaire.
Une nouvelle politique commerciale doit aussi respecter des conditions de concurrence équitables entre l’UE et les pays tiers, en ce qui concerne les contraintes environnementales, sanitaires et phytosanitaires.
S’il est vrai que les importations dans l’UE doivent respecter les normes sanitaires et phytosanitaires de l’UE, dans de nombreux pays exportateurs, des substances interdites dans l’UE sont largement utilisées. Le niveau des contrôles à nos frontières doit être à la hauteur de ces dangers.
Dans le domaine de l’environnement, la situation est encore pire. Les accords de libre-échange existants ne comportent que quelques clauses d’adhésion aux conventions des Nations unies.
L’UE importe un large éventail de produits provenant de zones déboisées, de la viande de bœuf à l’huile de palme. C’est inacceptable : l’UE devient ainsi un acteur actif de la déforestation par sa demande pour ces produits.
L’UE doit adopter une politique commerciale claire qui interdise les importations en provenance des zones déforestées et d’autres zones à haute valeur environnementale. L’UE dispose de moyens indépendants pour contrôler la déforestation et identifier les produits originaires de ces régions, et ne doit pas laisser la certification des produits déboisés à la bonne volonté des pays tiers ou à d’autres parties. L’UE devrait fixer une date butoir dans le passé pour l’acceptation des importations en provenance de zones précédemment déboisées et à haute valeur environnementale, en interdisant toutes les importations en provenance de zones dégradées après cette date.
Les contraintes environnementales de l’UE sont les plus strictes au monde. Cela a un coût pour le secteur, et ce coût n’est pas supporté par ses concurrents. En particulier, l’UE ne devrait pas accepter que les importations de produits agroalimentaires qui ont été produits sous des contraintes environnementales nettement moindres bénéficient d’avantages tarifaires.
Les conditions de concurrence dans le domaine des nouvelles technologies sont aujourd’hui en défaveur de l’agriculture européenne. L’UE ne s’est pas ouverte l’utilisation de techniques prometteuses qui ont le potentiel d’accroître la productivité et de réduire l’empreinte écologique, comme les nouvelles techniques de sélection. De son propre fait, l’UE place le secteur dans une position concurrentielle défavorable.
En ce qui concerne les conditions de travail, les règles du jeu équitables sont pratiquement inexistantes. Les ALE existants n’intègrent que l’adhésion aux conventions de l’OIT.
Bien qu’il s’agisse généralement d’une question transversale qui va plus loin que le commerce agroalimentaire, les ALE pourraient comporter des dispositions visant à régler les questions de salaire minimum dans des secteurs particulièrement sensibles. Par exemple, en ce qui concerne le commerce de la viande, le coût d’exploitation des abattoirs est important et la question est donc pertinente pour établir des conditions de concurrence équitables.
Une autre question transversale est la dévaluation compétitive de la monnaie. Il y a de bonnes raisons d’insérer dans les ALE des clauses qui contrent les dévaluations concurrentielles des monnaies.Une dévaluation de la monnaie a souvent un impact plus important en termes commerciaux que les droits de douane, et les politiques monétaires qui dévaluent intentionnellement une monnaie doivent être contrecarrées par des contre-mesures, par exemple en donnant à l’autre partie la possibilité d’augmenter les droits de douane.
Les changements de politique commerciale proposés par Farm Europe doivent être considérés dans le contexte de la réforme de la politique commerciale de l’UE en vue d’une orientation plus pragmatique et plus réaliste.
La nouvelle politique devrait apporter de la cohérence et une vision globale des coûts et avantages commerciaux. En ce qui concerne l’agriculture, elle devrait être en phase avec le modèle d’agriculture promu par l’UE, largement basé sur des exploitations familiales de taille moyenne fonctionnant avec leurs propres ressources limitées en capital.
LES ÉTATS-UNIS LANCENT UN TROISIÈME NIVEAU DE SOUTIEN À L’AGRICULTURE DANS LE CADRE DU COVID-19
Les lecteurs pourraient penser qu’ils ont déjà tout lu à ce sujet, mais le fait est qu’aux États-Unis, un nouveau paquet de soutien pour aider l’agriculture à faire face à la crise de Covid-19 a été lancé cette semaine. Ce paquet est le troisième depuis le début de la crise et vient s’additionner à ceux –conséquents – déjà connus.
Ce paquet consiste en un montant supplémentaire de 470 millions de dollars pour l’achat de produits de base, financé par les recettes douanières. La part la plus importante va aux produits laitiers, avec une allocation de 120 millions de dollars. Les pommes de terre, la dinde, le poulet, le porc, viennent ensuite dans une longue liste qui comprend une variété de fruits et quelques produits de la pêche.
Il est intéressant de rappeler l’ampleur du soutien dont les agriculteurs américains ont bénéficié jusqu’à présent pour faire face à la crise du Covid-19. Tout d’abord, les principaux programmes de soutien ont été augmentés de 14 milliards de dollars. Ensuite, une enveloppe de 19 milliards de dollars comprenant 16 milliards de paiements directs et 3 milliards d’achats de produits de base. Et enfin, ce dernier paquet de cette semaine, d’un montant de 470 millions de dollars. Au total, un montant stupéfiant de 33,47 milliards de dollars, soit un peu plus de 30 milliards d’euros.
Dans l’UE ? Le paquet de soutien spécifique Covid-19 annoncé pour l’agriculture est estimé à un montant de 80 millions d’euros.
La comparaison du soutien Covid-19 par agriculteur et par hectare aux États-Unis et dans l’UE, en euros, est éloquente :
- EUA : 15 415 € par agriculteur ; 73 € par hectare
- UE : 8 € par agriculteur ; 0,5 € par hectare
LA CRISE DU COVID-19 ET L’AGRICULTURE UE : CE DONT NOUS AVONS BESOIN ET CE DONT NOUS N’AVONS PAS BESOIN
Dans toute crise majeure, il y a un moment de déni, un moment de blâme et un moment d’évaluation. Nous vivons une crise majeure et sans précédent, une crise pour laquelle les États ont décidé d’arrêter l’activité économique afin de protéger des vies. Malheureusement, nombreux sont ceux qui nient encore l’impact inévitable de cette crise sur l’agriculture.
Farm Europe a écrit sur l’impact probable de la crise Covid-19 sur les marchés agricoles, et sur ce qu’il convient de faire pour anticiper le choc.
Nous voulons ici nous tourner vers l’avenir et contribuer à ce qui devrait être la réponse globale de la politique agricole de l’UE, et ce qu’il convient d’éviter à tout prix à ce stade.
La Commission européenne a fait part de sa volonté de réviser le CFP, la proposition de budget pluriannuel. Vous vous souvenez sans doute que la PAC avait été malmenée dans la proposition initiale, avec des réductions du budgétaires réel de 12 % sur la période de sept ans.
La crise actuelle a cependant montré une chose : nous avons besoin de sécurité alimentaire.Certains pays tiers ont annoncé des restrictions à l’exportation de denrées alimentaires. Quelle aurait été la situation dans l’UE si nous étions à court de denrées alimentaires ?
Farm Europe est d’accord avec ceux qui soulignent que la sécurité alimentaire ne peut être déléguée et que la PAC n’est pas une politique réservée aux seuls agriculteurs mais plutôt une politique au profit des citoyens de l’UE.
La sécurité alimentaire n’est pas réalisable au niveau local, seule une approche à l’échelle de l’UE permettra d’y parvenir. Nous ne préconisons pas un concept étroit et malavisé selon lequel chaque canton ou région devrait être autosuffisant, car cela n’est tout simplement pas faisable ni souhaitable. Ce n’est qu’à un niveau plus large comme celui de l’UE, avec un marché intérieur qui fonctionne, que nous pourrons parvenir à une véritable sécurité alimentaire. Nous ne préconisons pas non plus que l’UE ne fasse pas d’échanges commerciaux avec le reste du monde, car nous pouvons tirer profit du commerce et profiter de ses avantages économiques sans compromettre la sécurité alimentaire.
Nous devons également inverser le traitement défavorable réservé à l’agriculture dans la proposition de budget de l’UE. L’agriculture de l’UE a été le fondement de l’approvisionnement alimentaire des citoyens européens, même lorsque la majeure partie de l’économie est inactive. Elle est toutefois confrontée à des difficultés dues à la réduction et à la modification de la demande, à la suite de la fermeture de commerces, et, dans un avenir proche, à la réduction du pouvoir d’achat de nombreux consommateurs européens et mondiaux. La dernière chose dont l’agriculture européenne a besoin, c’est de nouvelles réductions des aides. Lorsque les lignes de vie sont étendues à des pans entiers de l’économie, il serait irresponsable de réduire le soutien à l’agriculture.
En revanche, nous n’avons pas besoin d’un ensemble de politiques qui alourdissent la charge de la production alimentaire dans l’UE. Nous n’avons pas besoin d’une stratégie « de la ferme à la fourchette », ou d’une stratégie en faveur de la biodiversité, qui ne feraient qu’accroître les restrictions sur l’utilisation des intrants, qui réduiraient la surface et la productivité agricoles et qui diminueraient les revenus des agriculteurs déjà mis à rude épreuve.
Farm Europe veut être très clair : nous pensons que les politiques de l’UE doivent contribuer à une meilleure protection de l’environnement et à la lutte contre le changement climatique. Mais cela doit aller de pair avec l’amélioration de la situation économique des agriculteurs et la garantie de la sécurité alimentaire.
En portant à 10 % les terres réservées à la biodiversité et à 30 % la production biologique, comme certains le proposent, on réduirait la production alimentaire de l’UE de 15 %, ce qui est stupéfiant. Réduire l’utilisation de pesticides et d’engrais sans fournir aux agriculteurs les investissements et la combinaison de technologies nécessaires pour atteindre des objectifs environnementaux significatifs entraînera une nouvelle réduction de la production alimentaire et des difficultés économiques pour les agriculteurs. C’est inacceptable.
C’est pourquoi le second besoin logique est de promouvoir les bons investissements dans l’agriculture, ceux qui permettent de réduire l’empreinte écologique et les émissions de gaz à effet de serre tout en maintenant ou en développant la production agricole, en assurant la sécurité alimentaire et en préservant les moyens de subsistance des agriculteurs.
Nous devons également renforcer la résilience du secteur. Comme Farm Europe l’a constamment préconisé, et comme la COMAGRI du Parlement européen l’a proposé, nous avons besoin d’une réserve de crise bien financée dans la PAC qui aurait les moyens et le mandat d’intervenir rapidement en temps de crise, en recourant à des mesures exceptionnelles et en consolidant les assurances et les fonds de mutualisation.
Cette crise du Covid-19 laissera des cicatrices pendant un certain temps et nous devons tirer les leçons des expériences passées qui ont montré que les outils actuels de gestion de crise de la PAC ne sont pas suffisants. La dernière crise des produits laitiers ou des fruits et légumes témoigne des problèmes auxquels nous avons été confrontés par le passé, à un coût économique et budgétaire élevé.
Ce dont nous n’avons pas besoin, c’est d’attendre et voir ce qui se passe, de nous asseoir et d’attendre que la crise se développe dans le secteur des produits laitiers, de la viande bovine, du vin, des fruits et légumes, du sucre, de l’éthanol ou dans tout autre secteur. Les producteurs de fleurs et de plantes ornementales sont déjà confrontés à d’énormes difficultés. Farm Europe appelle les décideurs, et en particulier la Commission européenne, à passer à la vitesse supérieure et à devenir plus proactifs que réactifs.
Crise Covid19 et secteurs agricoles européens : Mesures urgentes à prendre
La crise sanitaire Covid19 s’est installée, avec des effets importants sur les secteurs économiques. Ces effets risquent d’être durables, avec une récession qui guette l’Union Européenne et les autres économies mondiales.
Cette crise souligne aussi l’importance de la sécurité alimentaire. D’aucuns, dans l’Union Européenne, avaient pu avoir tendance à l’estimer acquise, voire de pouvoir faire de l’agriculture européenne le banquier de certaines négociations commerciales bi ou multilatérales.
La sécurité alimentaire n’est ni synonyme de repli sur une recherche d’autarcies locales qui n’ont jamais existé, ni d’un autodafé des échanges commerciaux avec des pays tiers. Elle est le juste équilibre entre la dynamisation des secteurs agricoles européens, un marché unique européen fort assurant une fluidité d’échanges, et des échanges avec le reste du monde répondant aux besoins demeurant de l’Union Européenne et répondant aux demandes des marchés mondiaux pour lesquelles l’Union Européenne doit assumer sa part de responsabilité en termes d’approvisionnement et de stabilité des dits marchés.
La sécurité alimentaire de l’Union Européenne constitue une des bases incontournables de son autonomie politique.
Pour qu’elle soit véritable, elle passe :
– par une politique européenne ambitieuse visant à l’essor des secteurs agricoles dans toutes les régions européennes -Farm Europe y consacrera une analyse spécifique avec des propositions d’actions-
– à très court terme par des mesures urgentes pour répondre à la crise économique dans laquelle nombre de secteurs agricoles plongent actuellement.
AU TITRE DES ACTIONS A PRENDRE SANS DELAI :
– Pour le secteur laitier : ce secteur souffre d’un déséquilibre entre offre et demande du fait d’un côté de la courbe saisonnière de hausse de la production (retour à l’herbe) et la contraction déjà notée de la demande de poudre au regard du ralentissement des exportations et de la demande de beurre de la part des industriels et de la fermeture de la restauration hors foyer. Pour mémoire, les dernières crises ont souligné la sensibilité du marché très tôt à tout déséquilibre. Une baisse de 3% de la demande engendre une crise avec effondrement des prix.
Rappelons nous que dans ce secteur, comme dans la majorité des secteurs agricoles, l’arrêt d’une exploitation agricole signifie sa disparition et un recul de la production. Au regard des investissements en jeu et de la typologie des exploitations agricoles européennes (essentiellement à capitaux familiaux), le passage d’une production animale à une végétale et inversement n’est pas la réalité de l’agriculture européenne et ne peut l’être.
—> afin d’éviter une chute des prix et la disparition de producteurs, la mise à l’intervention de produits doit être ouverte, ainsi que l’aide au stockage privé pour certaines productions mais surtout une mesure européenne d’encouragement à la réduction volontaire de production est urgente.
Il s’agira alors de veiller à ce que l’impact de cette mesure ne soit pas minimisée par des accroissements de production de producteurs qui y verraient un effet d’aubaine.
– Pour le secteur viande bovine : des difficultés majeures existent déjà sur les pièces nobles du fait de la fermeture de la restauration hors foyer, de la fermeture de rayons boucherie des supermarchés. Les consommateurs orientent leurs achats vers des achats pré-emballés et des produits rapides à cuisiner. Dans un contexte d’incertitudes, les consommateurs tendent, de plus, à déporter leurs achats sur des morceaux ou viandes moins chères.
Au regard de l’évolution différenciée des marchés pièces nobles / haché, il conviendrait de :
1) Ouvrir sans délai la mesure d’aide au stockage privé pour les pièces nobles (uniquement aux pièces nobles).
2) Veiller à l’équilibre de ce segment de marché au niveau européen en suivant finement les flux de mise en marché et d’importations de cette catégorie de viande de boeuf. Pour mémoire, la prime de marché pour ces pièces nobles n’existe pas au Brésil ou aux USA. De fait, ces producteurs sont en mesure d’exporter sur le marché communautaire avec une rentabilité réelle à un prix de vente intra-UE de 7 à 8 euros soit 1/3 plus bas que le prix de marché.
3) Activer les clauses prévues par la PAC 2013 permettant en temps de crise aux agriculteurs d’organiser ensemble les conditions de mise sur le marché de leurs productions.
S’agissant des secteurs viande, une attention doit être aussi portée au secteur ovin dont une partie importante du chiffre d’affaires annuel est remis en cause du fait de la crise actuelle et des confinements décidés.
– Pour le secteur du vin : les ventes via la grande distribution se sont maintenues en mars et le devraient aussi en avril. Cependant, celles à destination de la restauration hors foyer sont au point mort, celles via les commerces spécialisés sont réduites tout comme le flux d’exportations qui s’est contracté fortement. Comme pour les autres filières, les pertes de volumes commercialisés ne seront pas rattrapées. En plus de la chute de chiffres d’affaire actuelle, se pose le problème de l’arrivée de la nouvelle récolte dans des zones où les cuves seront pleines de stocks. Au problème financier pourrait donc s’ajouter un problème technique qui amplifiera le premier.
—> des mesures de distillation dans certaines régions doivent être envisagées dés lors qu’elles seront bien utilisées pour répondre à la crise Covid19 et non pour gommer des problèmes plus structurels d’adéquation aux marchés de certains vins ; de même un recours à la vendage en vert pourrait être envisagé.
—> des campagnes renforcées de promotion, notamment sur le marché UE, doivent être financées substantiellement dans le cadre de mesures européennes exceptionnelles,
—> une prolongation d’un an de la validité des autorisations détenues par les producteurs doit être décidée par dérogation à l’article 62 paragraphe 3 de Reg.1308/2013.
– Pour le secteur fruits et légumes : ce secteur subit de plein fouet l’effet de la crise, alors que sa période de production reprend. Il doit affronter des problèmes importants de main d’œuvre, un recul de la consommation de produits frais fruits et légumes avec un report des consommateurs sur les produits longue conservation, cuisinés ou simples à cuisiner, et des pertes de productions dont le délai de stockage est limité. Il s’agit donc tout à la fois d’assurer un équilibre entre demande et mises en marché afin de ne pas dégrader les prix – donc d’envisager des retraits de production à défaut d’une réorientation vers la transformation limitée par les capacités industrielles et l’équilibre propre des dits marchés – et un soutien financier au regard des pertes de revenus inévitables pour les productions de saison et un fléchissement pour les productions post-crise sanitaire tant que la consommation n’aura pas retrouvé ses niveaux antérieurs. Par ailleurs, des mesures de promotion de la consommation seront à prévoir dés la sortie de crise sanitaire.
– Pour le secteur des fleurs et pépiniéristes : ce secteur a connu un quasi-arrêt de son activité, avec à la clé des pertes de chiffres d’affaires et de récoltes. Des aides financières directes sont requises pour ces entreprises par activation des dispositions prévues à l’article 219 du règlement 1308/2013.
– Pour le secteur du sucre et de l’éthanol : ce secteur va être confronté à une situation très dégradée très rapidement. Le marché de l’énergie a baissé de façon importante, entrainant à sa suite les prix et les volumes de l’éthanol carburant. Le ralentissement de l’activité économique globale qui va suivre la fin de la crise sanitaire ne permet pas d’espérer une amélioration réelle. Trois conséquences pour les filières sucre et éthanol européennes :
– une plus forte disponibilité de sucre au niveau mondial du fait de la réorientation d’une partie des capacités d’éthanol du Brésil vers la production de sucre, et donc une baisse des cours mondiaux du sucre,
– une baisse des prix de l’éthanol sur le marché européen
– un ralentissement de la demande d’éthanol sur le marché américain qui se soldera par des quantités US qui seront réorientées vers le marché mondial et donc seraient susceptibles, sans précaution, d’inonder le marché européen.
—> dès lors, il convient de prendre des mesures urgentes préservant à la fois la rentabilité pour les productions européennes sur le marché européen et une certaine fluidité des échanges mondiaux de sucre. La Commission doit s’engager sans tarder dans une analyse des équilibres de marché et définir les actions régulatrices des importations et de leur prix à prendre afin de préserver le marché européen, notamment à très court terme de l’éthanol.
– Pour le secteur céréales : le secteur européen des céréales et grandes cultures subira le double impact d’une récession très probable au niveau mondial, du faible prix de l’énergie, de la baisse prévisible des cours US de maïs et d’une politique commerciale agressive des Etats Unis sur les marchés agricoles, politique déjà marquée avant la crise sanitaire par l’accord Chine-USA qui relègue au second plan des priorités chinoises les sources européennes d’approvisionnement.
Au delà des actions spécifiques à prendre pour chaque secteur, un plan européen de crise doit être préparé pour l’ensemble des secteurs afin de préserver le maximum de structures des chutes de marges auxquelles elles risquent de devoir faire face. Ce fonds doit pouvoir apporter aux agriculteurs des aides directes de compensation partielle de pertes de marge et des garanties de prêts de trésorerie. Un plan européen d’aides financières à la perte de marges doit être mis en place.
L’ensemble de ces mesures doit être financé par abondement du budget PAC. Il ne ferait aucun sens de diminuer les aides directes PAC aux agriculteurs pour financer un fonds de crise de sauvetage de l’agriculture européenne.