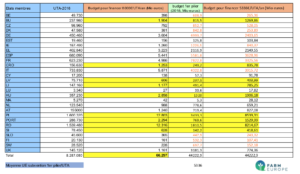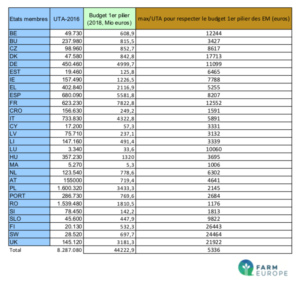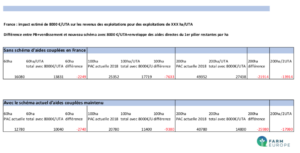En réponse aux défis environnementaux et climatiques et aux attentes sociétales, le projet de PAC post-2020 se propose d’élever ses ambitions environnementales pour faciliter et encourager la prise en compte de ces enjeux dans les pratiques agricoles. Un équilibre entre les dimensions économique et environnementale est essentiel à trouver afin d’assurer la stabilité et une rentabilité du travail pour les agriculteurs et de mettre en place une PAC durable (Jereb et al., 2017; COMAGRI, 2019).
Le plan Ecoscheme est un nouvel outil proposé dans la réforme de la PAC post-2020 qui se veut être moteur d’une transition vers une agriculture plus durable (COMAGRI, 2019). Il remplace le verdissement des aides au revenu instauré lors de la réforme de 2013. Tout comme les mesures de verdissement, le plan Ecoscheme permet de consacrer une part des paiements directs à la protection de l’environnement et au climat (COMAGRI, 2019).
Le contenu du plan Ecoscheme a comme double objectif de garantir une unité d’action et d’ambition tout en étant suffisamment flexible pour répondre aux enjeux locaux. Une idée pour atteindre ce but serait de stimuler la transition vers des systèmes agricoles plus durables.
Face aux reproches récurrents concernant l’absence de quantification des effets de la PAC, des outils politiques simples et offrant un suivi solide des résultats à travers l’Europe sont souhaités, tant par des acteurs du monde agricole que par les décideurs européens.
Le lien entre agriculture et environnement est à maintenir et à renforcer, dans la continuité des PAC précédentes. Les nouveaux outils à disposition de l’agriculture affirment assurer des résultats économiques et environnementaux. Si c’est le cas, ils permettraient d’atteindre cette double performance économique et environnementale. Plus répandus, ils pourraient assurer une évaluation précise de l’effet des politiques mises en place.
Ainsi, face à l’enjeu de la définition d’un cadre européen pour l’Ecoscheme et d’une mise en œuvre portant des fruits concrets, cette étude a trois objectifs. Le premier but est d’analyser qualitativement différents systèmes agricoles pour discerner ceux vers lesquels promouvoir une transition. Le second consiste en la mise en place d’un ensemble d’indicateurs permettant de mesurer quantitativement l’impact de ce plan au sein des exploitations. Le dernier objectif est d’évaluer les performances économiques et environnementales des différents systèmes agricoles avec et sans le recours à l’agriculture de précision.
note complète disponible sur l’espace Membres de Farm Europe