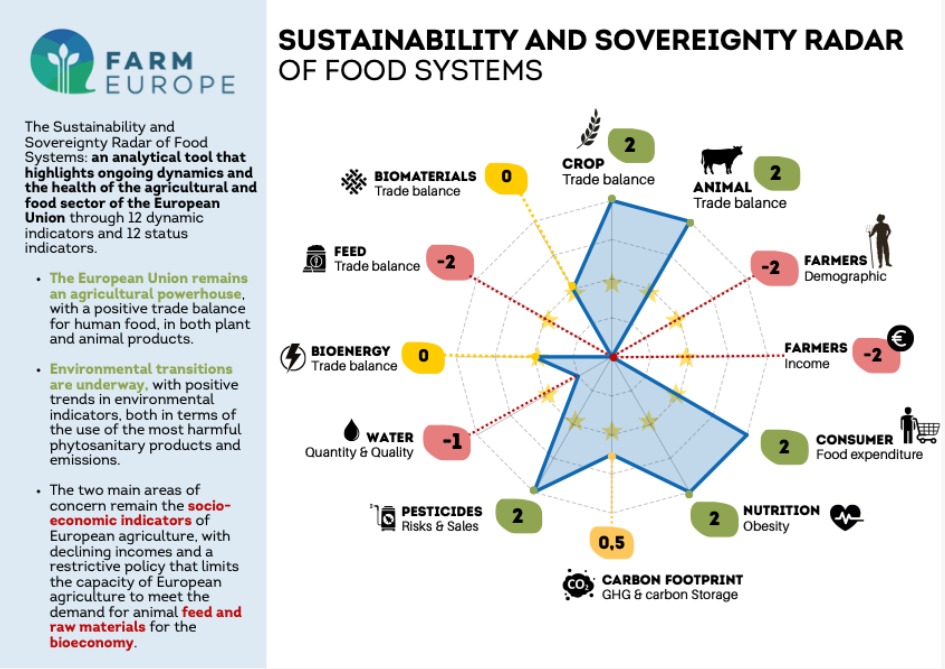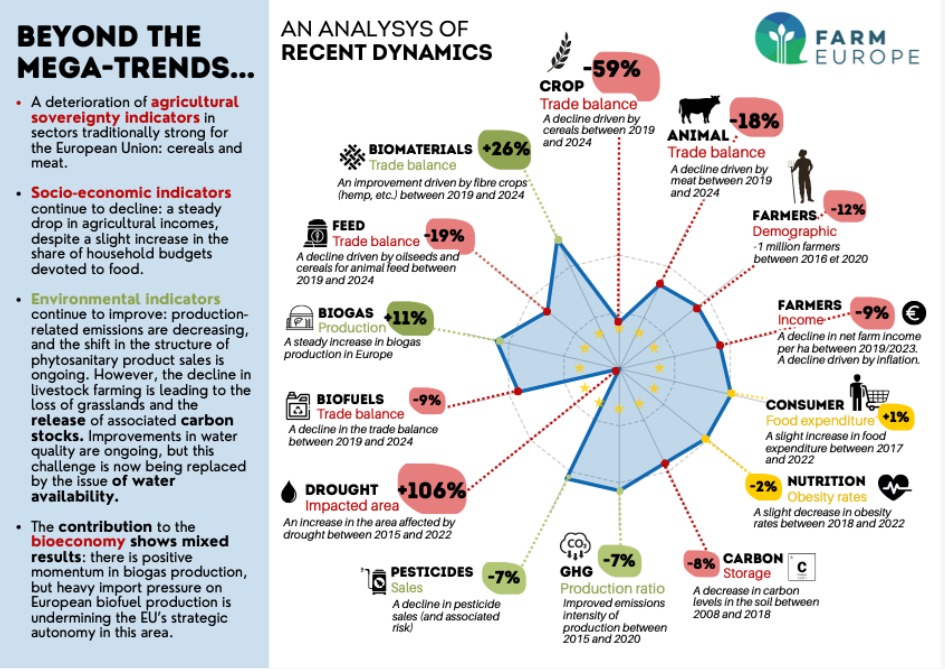Le 1er juillet marque le début de la Présidence danoise du Conseil de l’Union européenne, que le Danemark exercera jusqu’au 31 décembre 2025. Sous le slogan « Une Europe forte dans un monde en mutation », la Présidence danoise ambitionne de contribuer à la construction d’une Europe sûre, compétitive et verte.
De manière générale, le programme de la future présidence vise à renforcer le rôle de l’Europe dans un monde marqué par l’instabilité géopolitique et une concurrence internationale croissante. Le pays entend garantir que l’UE puisse mieux assurer sa propre défense, notamment face aux défis posés par la Russie et aux incertitudes transatlantiques.
Une des priorités principales consistera à améliorer la compétitivité économique de l’UE en réduisant les charges réglementaires – y compris dans le secteur agricole – et en stimulant l’innovation, tout en maintenant la dynamique de transition écologique en amont de la COP30, considérée comme essentielle tant pour la sécurité que pour la prospérité à long terme. Une impulsion est à prévoir sur les protéines alternatives et la biotechnologie.
Voici les éléments les plus pertinents mentionnés dans le programme :
- Cadre financier pluriannuel
La Présidence danoise œuvrera pour un budget de l’UE financièrement responsable, qui apporte une réponse ciblée, simple et efficace aux défis stratégiques de l’Union. Le Danemark entend tracer une voie ambitieuse et rigoureuse sur le plan budgétaire pour les travaux du Conseil, en visant la présentation d’un premier projet de « boîte de négociation » afin d’orienter les discussions. Le Danemark a d’ores et déjà souligné qu’il privilégiera la qualité des dépenses plutôt que le montant global. Dans ce contexte, la Présidence poursuivra les discussions sur une éventuelle révision de la décision du Conseil relative aux ressources propres.
- Politique agricole commune post-2027
En ce qui concerne la prochaine Politique agricole commune, la Présidence danoise s’emploiera à simplifier le quotidien des agriculteurs, pêcheurs et producteurs alimentaires, à travers une meilleure réglementation, mais aussi par l’innovation et le développement.
Le Danemark concentrera ses efforts sur quatre priorités clés pour la PAC post-2027 :
- Une PAC verte, simple et orientée vers le marché
La Présidence danoise veillera à promouvoir une PAC verte, simple et orientée vers le marché, qui soutienne les mesures en faveur du climat et de l’environnement tout en renforçant la compétitivité et l’innovation.
Dans ce cadre, la Présidence entend conclure les négociations sur le paquet de simplification agricole et entamer celles sur la nouvelle PAC, en soulignant qu’elle doit appuyer le développement rural, l’agriculture biologique, le renouvellement générationnel et le bien-être animal, tout en assurant une meilleure cohérence avec la législation sectorielle, notamment climatique et environnementale.
- Un secteur agroalimentaire innovant et compétitif
Jouant un rôle crucial dans le développement de cultures résilientes, la Présidence œuvrera à finaliser les négociations sur les propositions relatives aux plantes issues des nouvelles techniques génomiques. L’économie biosourcée et les solutions biotechnologiques contribuent également de manière significative à une production agricole et alimentaire durable. La Présidence accordera donc une attention particulière au futur EU Biotech Act, en insistant sur le besoin de flexibilité, de réduction des charges administratives et de simplification réglementaire.
- Un système alimentaire durable et un marché intérieur solide
Concernant le renforcement de la position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, la Présidence danoise est déterminée à conclure les négociations sur les pratiques commerciales déloyales transfrontalières et les propositions de modification de l’Organisation commune des marchés. En outre, elle mettra l’accent sur le potentiel d’un plan d’action européen commun pour les aliments d’origine végétale ainsi qu’une stratégie protéique européenne.
- Un marché unique axé sur la santé animale, humaine et végétale
La Présidence danoise entend faire avancer les négociations sur la proposition relative à la protection des animaux pendant le transport. Par ailleurs, elle se penchera sur l’identification de solutions face à la résistance antimicrobienne, aux maladies animales transmissibles et à l’apparition de nouveaux ravageurs des plantes.
- Élargissement
La Présidence danoise considère l’élargissement futur de l’UE comme une nécessité géopolitique, notamment avec l’Ukraine, estimant qu’il s’agit du seul moyen pour l’UE de stabiliser efficacement le continent européen et de renforcer la résilience des pays vulnérables aux influences extérieures indésirables.
- Politique climatique
La lutte contre le changement climatique et la réalisation des objectifs de réduction des émissions de l’UE figureront parmi les thématiques phares de la Présidence danoise. Le Danemark entend conclure un accord sur la révision de la Loi européenne sur le climat, établissant une réduction nette des émissions de GES de 90 % d’ici 2040. Il devra pour cela respecter un calendrier serré, notamment car l’UE doit soumettre – conformément à l’Accord de Paris – sa nouvelle contribution déterminée au niveau national (CDN) pour la période allant jusqu’en 2035 avant la COP 30, prévue au Brésil du 10 au 21 novembre 2025.
L’objectif de la Présidence danoise est de dériver la cible 2035 à partir de celle fixée pour 2040, ce qui impliquerait de trouver un accord avec le co-législateur d’ici septembre. Il reste cependant incertain que le Danemark puisse avancer ces dossiers en parallèle, ou s’il devra les traiter séparément. Cette question est cruciale car elle conditionne le niveau d’ambition des objectifs. Une trajectoire linéaire placerait l’objectif 2035 à mi-chemin entre 2030 et 2040, garantissant ainsi une progression cohérente. Une dissociation pourrait au contraire permettre un objectif moins ambitieux pour 2035, au risque de compromettre celui de 2040.
Les négociations sur ce dossier sont également sous pression en raison de la position de la France, exprimée par le Président Macron lors du dernier Conseil européen. Celui-ci souhaite reporter les discussions sur l’amendement de la Loi climat pour permettre un « débat démocratique au sein du Conseil », et s’oppose à l’idée de déduire l’objectif 2035 de celui de 2040, affirmant que seul le premier doit être défini en urgence. D’autres États membres, comme la Hongrie, partagent cette position, même si la majorité semble s’aligner avec celle du Danemark.
Par ailleurs, la Présidence donnera la priorité au renforcement du Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (CBAM), afin de prévenir les fuites de carbone tout en soutenant la transition verte et la compétitivité européenne.
- Politique environnementale
En matière environnementale, la Présidence danoise engagera les discussions sur la politique environnementale de l’UE à l’horizon 2030.
Conformément à son programme, le Danemark cherchera à faire progresser les négociations pour renforcer l’économie circulaire et améliorer l’autonomie stratégique de l’UE en sécurisant l’approvisionnement en ressources naturelles critiques. Les discussions politiques sur la future stratégie européenne de bioéconomie seront un point clé. Farm Europe souhaite que cette stratégie permette une réflexion approfondie sur la disponibilité de la biomasse et le rôle de la production agricole dans son approvisionnement.
De plus, le Danemark soutiendra les efforts internationaux pour adopter un accord juridiquement contraignant des Nations Unies visant à mettre fin à la pollution plastique (la prochaine session de négociation aura lieu du 5 au 14 août à Genève) et conduira les discussions du Conseil sur la Stratégie européenne de résilience hydrique, en traçant une feuille de route pour garantir l’approvisionnement et la qualité de l’eau, renforcer la résilience et promouvoir l’innovation dans les technologies de l’eau.
La Présidence est également prête à lancer les négociations sur la révision de la législation européenne sur les produits chimiques (REACH), afin de moderniser et simplifier le cadre législatif, soutenir la production durable de produits chimiques et garantir la sécurité des consommateurs, notamment en traitant les substances dangereuses et les PFAS inutiles.
- Politique énergétique
Le Danemark souhaite faire progresser, voire conclure, les négociations sur la révision de la directive sur la taxation de l’énergie ainsi que sur le plan d’action pour une énergie abordable proposé par la Commission.
- Transports
Dans le domaine des transports, la Présidence danoise vise à finaliser un accord avec le Parlement européen sur le règlement relatif à la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre provenant des services de transport. Elle lancera également les premières discussions sur le plan d’investissement durable dans les transports, destiné à accélérer la transition verte du secteur.
Concernant le transport maritime, la Présidence défendra un secteur maritime durable, innovant et compétitif, afin de préserver le leadership mondial de l’UE. En ligne avec les objectifs climatiques de l’UE à l’horizon 2030, l’agenda de simplification administrative de la Commission et le renforcement de la compétitivité, elle fera progresser les discussions sur la stratégie industrielle maritime. La Présidence soutiendra également l’adoption du cadre IMO de neutralité climatique lors de l’Organisation maritime internationale en octobre 2025, et entamera les travaux pour en assurer la mise en œuvre effective au niveau européen.