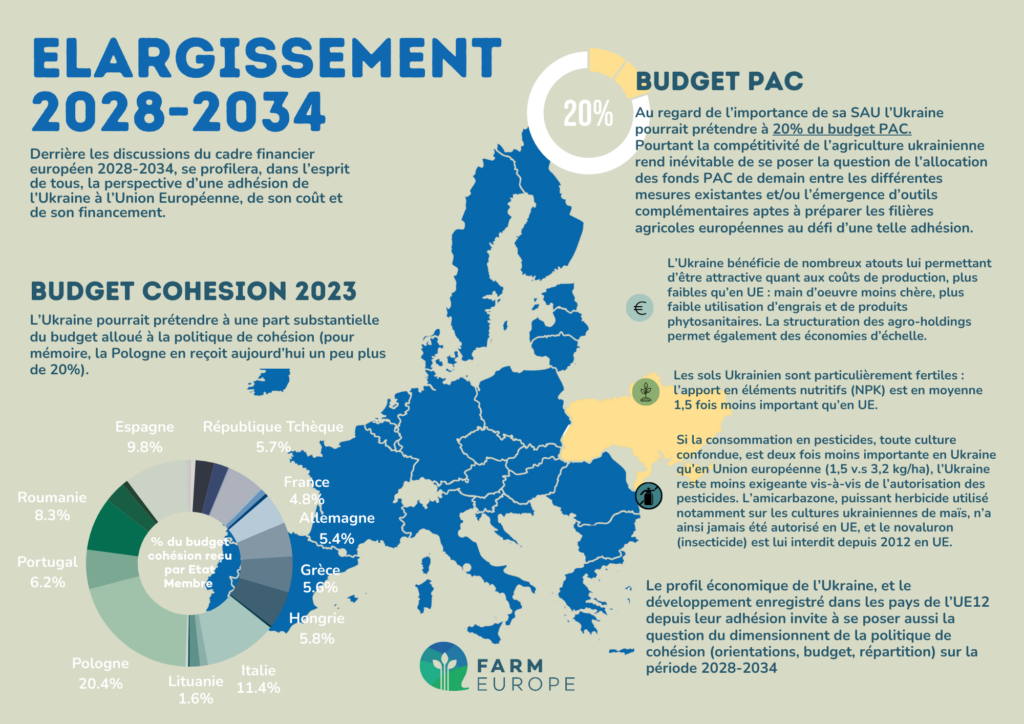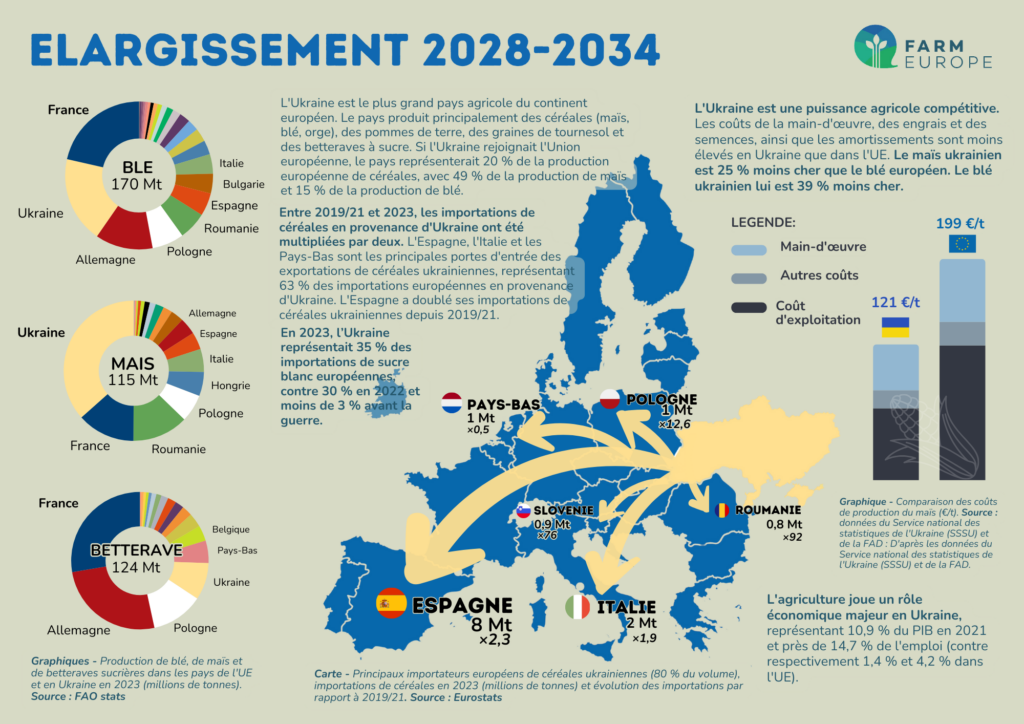Farm Europe se félicite de l’annonce, par la Commission européenne, du lancement d’un processus de travail dédié à l’élevage et souhaite pleinement contribuer à la construction en présentant ses propositions pour une stratégie renouvelée de l’Union européenne pour son secteur de l’élevage. Farm Europe estime que l’Union européenne doit tourner la page de cinq années d’idées reçues et d’une vision erronée, pessimiste et négative de l’élevage. Face aux défis nutritionnels, économiques, climatiques et environnementaux, l’élevage « Made in Europe » est une opportunité, tant pour notre continent que pour la planète. En période de tensions géopolitiques, l’UE doit plus que jamais garantir son autonomie stratégique.
“Une stratégie ambitieuse pour le secteur de l’élevage de l’UE doit pouvoir s’appuyer sur une boîte à outils complète pour consolider les acquis, un soutien économique pour mieux protéger et aider le secteur à rebondir, et des investissements ciblés pour relever les défis et construire le secteur de l’élevage de demain, capable d’irriguer tous les territoires de notre continent, des zones les moins favorisées comme les montagnes aux zones intermédiaires comme les plus productives où la complémentarité entre les cultures et l’élevage est un atout”, a souligné Ettore Prandini, chair of the Strategic Committee de Farm Europe à l’occasion de la Conférence sur l’avenir de l’agriculture et de l’alimentation organisée par la Commission européenne. .
La future stratégie devra permettre de :
- Relancer la production en Europe
- Optimiser pleinement les bénéfices positifs de l’élevage
- Investir et préparer l’avenir
- Mettre fin à la frénésie normative au profit d’une stratégie permettant de créer de la valeur ajoutée et de la segmentation sur les marchés
- Valoriser pleinement et contribuer au déploiement de la bioéconomie
Ces cinq principes de base doivent permettre au secteur de l’élevage du futur d’être économiquement résilient, au cœur d’une véritable stratégie de souveraineté agricole européenne et, enfin, pleinement engagé dans la lutte contre le changement climatique, le bien-être animal et la protection des ressources naturelles par une réelle valorisation de ses contributions et une optimisation de ses impacts, ainsi qu’une source de prospérité.
Ils doivent également permettre de construire une vision commune et partagée au niveau de l’Union européenne, en faisant de la diversité des territoires et des savoir-faire de l’Union une richesse. Enfin, ils seront un levier fondamental pour redonner de l’attractivité aux filières d’élevage auprès d’une nouvelle génération d’éleveurs engagés et confiants dans leur avenir.
Pour permettre la construction d’un consensus solide, Farm Europe recommande à la Commission européenne de reprendre l’approche qui a démontré son efficacité pour le secteur du vin à travers la création d’un Groupe de Haut Niveau en réunissant des responsables européens, des représentants des acteurs économiques et des représentants des ministères nationaux et des autorités régionales les plus impliqués dans l’avenir de l’élevage dans l’Union.
Une telle initiative doit permettre non seulement de faciliter l’émergence d’un consensus, mais aussi de développer une feuille de route précise pour sa mise en œuvre au cours des cinq prochaines années, offrant ainsi la visibilité nécessaire aux acteurs économiques ébranlés par le climat d’incertitude créé par les campagnes négatives orchestrées et instrumentalisées de ces dernières années.
Dans ce cadre, rassemblant le fruit des travaux et réflexions récentes, Farm Europe a préparé sa contribution initiale à ce que pourrait être une stratégie élevage, sous la forme d’une brochure rappelant que ce secteur est une chance pour l’Europe, et l’importance de la complémentarité entre le monde animal et végétal. Ce document est disponible ici, et servira de base aux futurs travaux de Farm Europe.