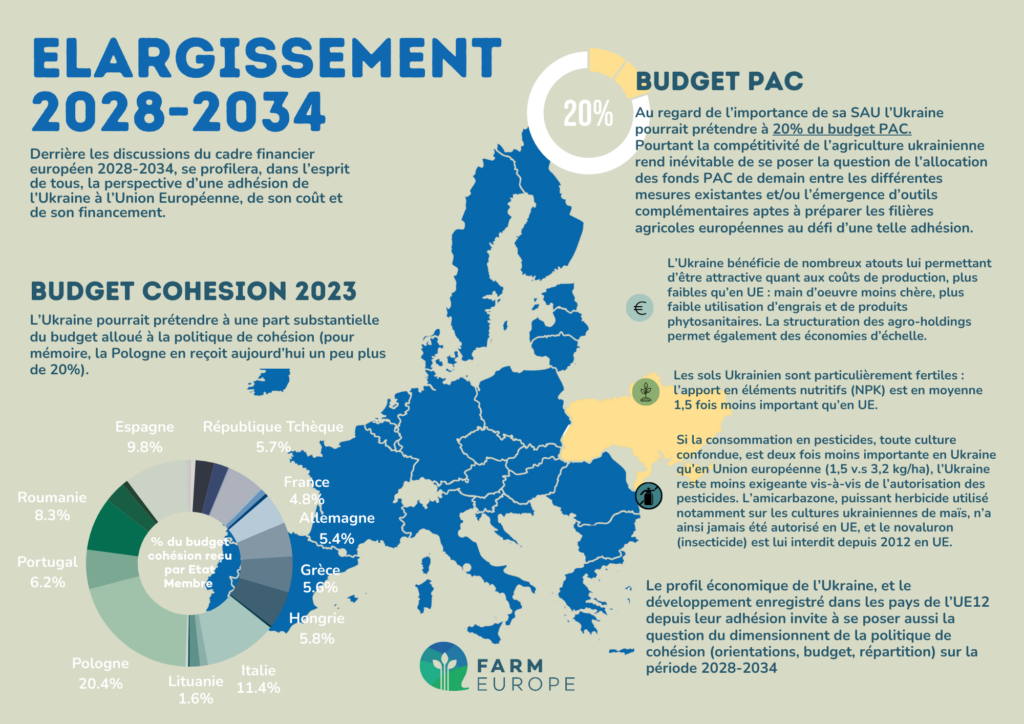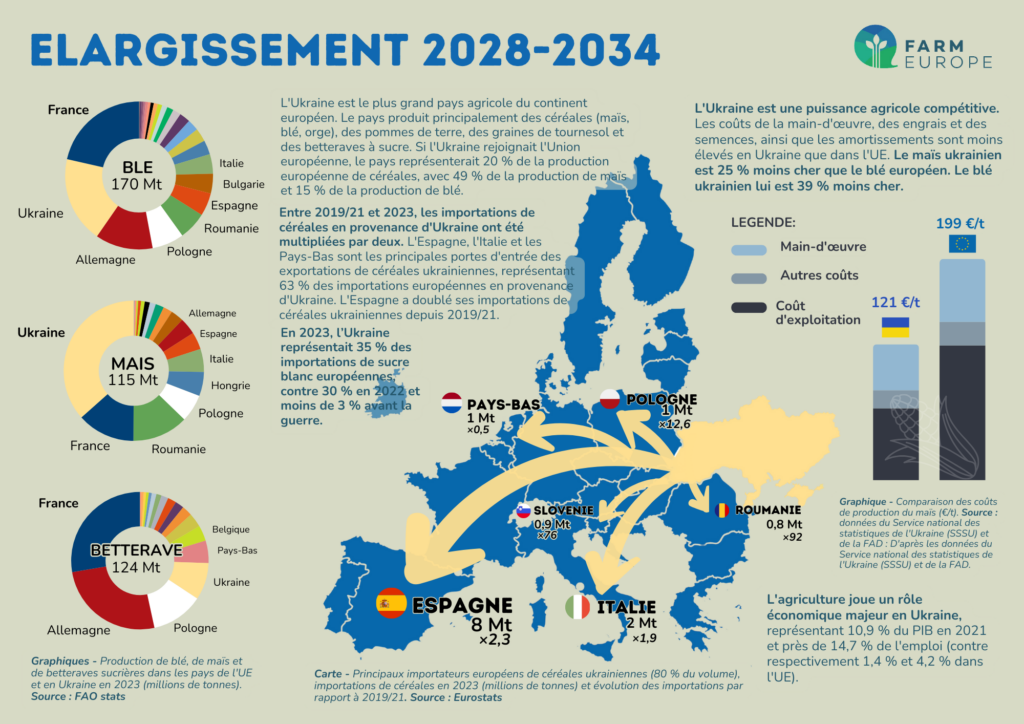La deuxième présidence Trump qui s’annonce peut avoir des conséquences dramatiques sur l’agriculture de l’UE, tant sur le plan commercial que sur le plan politique.
Ce qui nous vient immédiatement à l’esprit, c’est le risque accru de frictions commerciales, voire de guerres commerciales, qui pourraient, d’une manière ou d’une autre, avoir des répercussions sur l’agriculture de l’UE.
La présente note examine les différents scénarios en ce qui concerne les problèmes commerciaux, mais va plus loin et met en évidence un autre impact majeur probable – sur le Green Deal de l’UE.
En examinant ce qui pourrait se produire, nous n’entrerons pas dans le débat sur les avantages ou les inconvénients de droits de douane plus élevés, qui, bien que d’une importance réelle, mériterait une analyse économique spécifique et approfondie, bien au-delà de l’objectif plus ciblé de cette note.
COMMERCE
Sur le front du commerce, Donald Trump n’a cessé de parler d’une augmentation des droits de douane sur les importations américaines. Il a également désigné la Chine comme l’une des principales cibles des hausses tarifaires américaines.
Il ne s’agit pas d’une nouveauté, puisque lors de sa première présidence, il s’en est pris à la Chine et a augmenté les droits de douane sur les importations d’acier et d’aluminium, ce qui, on s’en souvient, a eu un impact sur l’UE et a conduit à des négociations difficiles après une série de mesures de rétorsion commerciale.
Qu’est-ce qu’une deuxième présidence Trump pourrait apporter de nouveau ?
Plusieurs scénarios sont possibles :
- Les États-Unis pourraient augmenter leurs droits de douane de manière générale, ce qui porterait leurs droits de douane moyens pondérés d’un peu plus de 2 % à 10 ou 20 %. En ce qui concerne la Chine, les États-Unis augmenteraient probablement leurs droits de douane encore plus, le chiffre de 60 % ayant été avancé.
La difficulté de ce scénario est qu’il aurait un impact sur tous les pays du monde, y compris les États-Unis, qu’il déclencherait très probablement des mesures de rétorsion de la part des pays concernés et qu’il ne laisserait que très peu de marge de négociation.
Les États-Unis bénéficieraient d’une protection accrue pour certains de leurs secteurs sensibles, mais perdraient des marchés d’exportation et verraient augmenter le coût des importations (et des intrants), même dans les secteurs où la nouvelle administration ne cherche pas à délocaliser sa base industrielle.
L’UE riposterait très certainement en augmentant les droits de douane et en réduisant ainsi les importations américaines.
Nos exportations agricoles vers les États-Unis seraient réduites. Bien que nous puissions remplacer les États-Unis sur certains marchés de pays tiers qui auraient également augmenté les droits de douane sur les importations américaines, le bilan final serait négatif pour nos intérêts, car nous bénéficions actuellement d’un important excédent commercial avec les États-Unis.
M. Trump pourrait également éprouver des difficultés à faire adopter cette hausse générale des droits de douane par le Congrès. Alors que pour des droits de douane spécifiques, il pourrait avoir le pouvoir d’agir, il est peu probable que ce pouvoir puisse être étendu à une mesure aussi globale.
Je considère donc cette option comme peu probable.
- Les États-Unis pourraient augmenter leurs droits de douane principalement à l’encontre de la Chine et de quelques autres produits et pays, en ciblant les domaines où des droits de douane plus élevés seraient plus efficaces pour ramener l’industrie aux États-Unis et protéger les secteurs sensibles. Les États-Unis pourraient également exiger la réciprocité sur certains produits spécifiques, c’est-à-dire que les pays tiers appliquent les mêmes droits de douane que les États-Unis.
L’UE pourrait être touchée sur les voitures, l’acier et d’autres produits industriels, mais aussi directement sur l’agriculture, car Trump s’est montré virulent à l’égard de l’UE pour avoir restreint les exportations de produits alimentaires américains. Cela déclencherait inévitablement des représailles contre les importations américaines.
À partir de là, trois solutions sont possibles : les deux parties s’en tiennent à des droits de douane plus élevés et ciblés mutuellement ; les représailles déclenchent des contre-rétorsions et une guerre commerciale ; un règlement négocié est trouvé sous une forme ou une autre.
Les perspectives pour les exportations agricoles de l’UE vers les États-Unis dépendront des produits qui seront visés par les droits de douane plus élevés des États-Unis. Il est très difficile de le prévoir, mais la perspective est réelle.
Ce scénario pourrait être plus attrayant pour la nouvelle administration. Il lui permettrait d’exercer des pressions et de se contenter d’un accord mieux négocié.
Dans les deux scénarios, l’impact de droits de douane beaucoup plus élevés sur les exportations chinoises vers les États-Unis se ferait également sentir dans l’UE. La Chine se retrouverait avec davantage de marchandises à exporter à des prix encore plus bas vers l’UE (et le reste du monde). L’UE se sentirait probablement obligée de se protéger, et pourrait même le faire dans le cadre d’un accord avec les États-Unis. La Chine, quant à elle, ne resterait pas les bras croisés pendant que ses exportations sont prises pour cible. Ainsi, les exportations agricoles de l’UE pourraient facilement figurer sur la liste des mesures de rétorsion de la Chine.
Par ailleurs, dans les deux scénarios, l’OMC serait encore plus mise à l’écart, au point de tomber dans l’oubli. Le recours au mécanisme de règlement des différends de l’OMC ne serait pas une option viable pour dissuader la nouvelle administration américaine.
LE PACTE VERT
Les problèmes commerciaux évoqués ci-dessus résulteraient de l’initiative des États-Unis de rompre les engagements pris dans le cadre de l’OMC et d’imposer unilatéralement des droits de douane à d’autres pays sans aucun argument juridique valable accepté au niveau international. L’exception de l’OMC qui permet aux membres de maintenir des mesures autrement incompatibles avec l’OMC – telles que des tarifs discriminatoires ou des quotas ou interdictions d’importation – pour des raisons de sécurité nationale, ne peut pas justifier toutes les mesures, et encore moins une augmentation généralisée des tarifs.
Venons-en maintenant au Green Deal de l’UE.
Le SCEQE (système d’échange de quotas d’émission) est un mécanisme qui limite et fixe le prix des émissions de carbone au sein de l’UE, créant ainsi un marché pour les quotas d’émission. Le CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, mécanisme d’ajustement carbone aux frontières) permet d’égaliser les coûts du carbone pour les produits importés, en appliquant une taxe différentielle à la frontière.
Dans l’état actuel des choses, l’applicabilité du Green Deal, sans conséquences dévastatrices pour nos économies, dépend de la mise en œuvre du CBAM. Sans le CBAM, les industries soumises à des réductions d’émissions obligatoires et à un système d’échange de quotas d’émission réellement mordant seraient confrontées à un choc à double tranchant : des coûts de production plus élevés et une concurrence accrue de la part des importations. Ce serait la recette d’un désastre, qui serait très probablement politiquement (et socialement) inacceptable.
Le CBAM est déjà en cours de déploiement, mais la mise en œuvre de véritables taxes aux frontières est prévue à partir de 2026, lorsque la distribution gratuite des certificats ETS prendra fin.
Ainsi, en 2026, l’UE commencera à taxer les importations de ciment, d’électricité, d’engrais, de fer et d’acier, d’hydrogène d’aluminium et de certains précurseurs et produits en aval fabriqués à partir de ciment, de fer et d’acier et d’aluminium, lorsque leurs émissions sont supérieures à ce qui est accepté au sein de l’UE.
Contrairement à ce qui se passerait si (quand) les États-Unis augmentaient unilatéralement leurs droits de douane, ce serait maintenant l’UE qui le ferait.
La nouvelle administration américaine prendra très probablement des mesures de rétorsion. Même si certains républicains sont prêts à imposer des taxes carbone sur les importations, ce qui concernerait surtout la Chine, ils n’accepteront jamais que les exportations américaines soient taxées pour cette raison.
Notre droit d’appliquer une taxe sur les émissions de gaz à effet de serre en vertu des règles de l’OMC n’a pas été mis à l’épreuve. L’UE sait qu’elle se trouve en terrain instable et il est entendu qu’elle privilégierait la sécurisation de son terrain par le biais d’accords avec les pays concernés. Cela pourrait s’avérer difficile, voire improbable, mais malgré cela, les États-Unis ne s’assiéraient pas pour accepter un CBAM de l’UE et n’attendraient pas la décision d’un groupe spécial de l’OMC pour réagir.
Qui plus est, les États-Unis seraient probablement suivis par d’autres grandes économies, comme l’Inde et la Chine. Même le Royaume-Uni se trouverait dans une position difficile, car le fait d’accepter l’UE et de mettre en œuvre son propre CBAM le mettrait à la croisée des chemins avec les États-Unis.
Il en résulterait que soit l’UE va de l’avant avec le Green Deal et accepte qu’une grande partie de ses industries soit mise dans une situation difficile en raison de coûts de production plus élevés et d’exportations plus faibles, avec toutes les conséquences économiques, sociales et politiques, soit l’UE suspend l’application des éléments essentiels du Green Deal, à commencer par le système d’échange de quotas d’émission et le mécanisme de garantie des crédits carbone.
La première option est très improbable, car elle entraînerait une réduction de la protection sociale et de l’emploi. Si maintenant, à un stade précoce de la mise en œuvre du Green Deal, l’opposition politique et sociale s’intensifie à mesure que les coûts deviennent plus clairs, et que ces coûts augmenteront fortement si l’UE maintient le cap de la mise en œuvre du Green Deal, à quoi ressemblerait la réaction ? Les politiciens et le public ont maintenant une conscience aiguë des conséquences, et je m’attends à ce que les mesures clés du Green Deal soient suspendues et que l’UE retourne à la planche à dessin pour trouver la meilleure façon d’avancer.
Bien que seule l’industrie européenne soit directement concernée par le système d’échange de quotas d’émission et les fortes réductions d’émissions, l’agriculture serait également sur la sellette en ce qui concerne les engrais, sans parler des probables représailles commerciales.
En outre, l’interruption de la mise en œuvre des principaux éléments du Green Deal ouvrirait la voie à une réévaluation plus large de la manière dont l’UE doit lutter contre le changement climatique et des mesures à mettre en œuvre sans mettre en péril le tissu économique et social de l’UE.
C’est d’une importance capitale pour l’agriculture européenne. La question n’est pas de savoir si le changement climatique est réel et s’il a un impact. La question est de savoir quelle est la meilleure façon de relever ce défi. Il s’agit de lutter contre le changement climatique sans réduire notre bien-être et notre autonomie stratégique.
Pour conclure, une administration Trump comporte certainement un risque accru de conflits commerciaux, mais elle offre également l’occasion de repenser la manière dont nous traitons le changement climatique dans l’UE.
Elle apporte d’une part la perspective négative d’une réduction des opportunités commerciales, mais elle ouvre d’autre part la possibilité de réoutiller le Green Deal pour lutter contre le changement climatique sans réduire notre bien-être, en passant à une approche technologique et incitative.