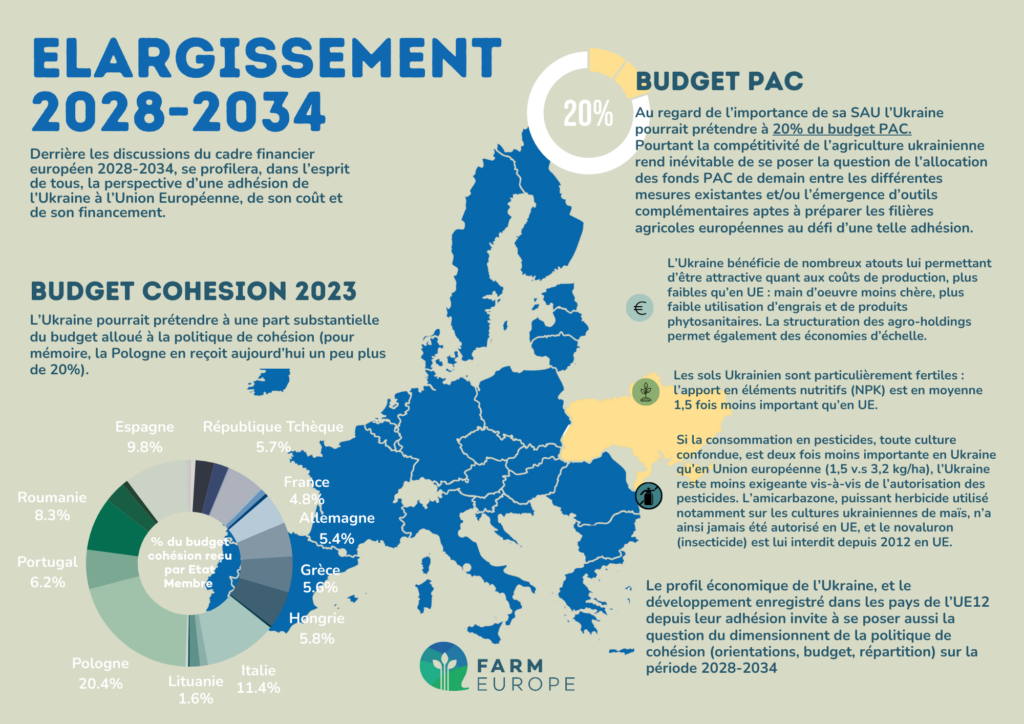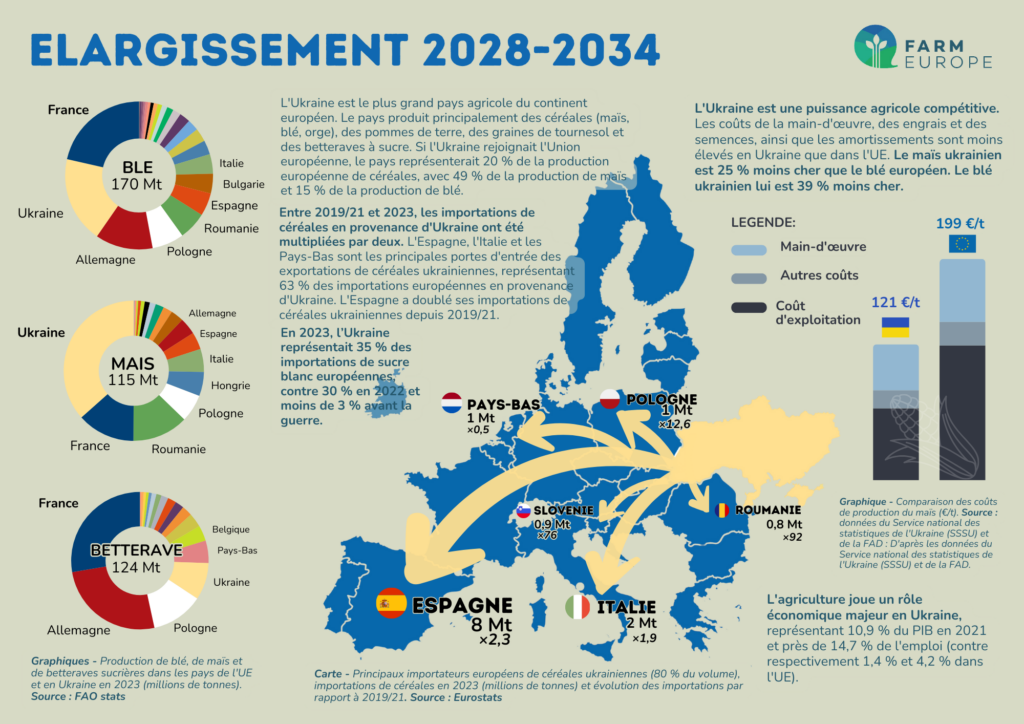Il est désormais fort probable que la décision des États-Unis de rétablir les droits d’importation sur l’acier et l’aluminium en provenance de l’UE, ainsi que la réponse inévitable de l’UE par des mesures de représailles, conduisent à une guerre commerciale dont la fin n’est pas en vue.
L’UE prévoit de rétablir ses mesures de représailles, suspendues depuis plusieurs années après une trêve négociée. Celles-ci incluent certaines exportations agricoles américaines, comme le maïs et le soja, mais aussi d’autres produits clés – comme le bourbon – qui pourraient déclencher de lourdes contre-mesures de la part des États-Unis.
Le Président américain a d’ailleurs publiquement déclaré que les États-Unis riposteraient avec encore plus de vigueur, menaçant d’imposer des droits de douane de 200 % sur les vins européens.
Le décor est donc planté pour une guerre commerciale entre les États-Unis et l’UE, et malheureusement l’agriculture en fait partie, bien qu’elle n’ait pas été le point de départ du conflit.
Nous examinerons ce que cela signifie pour le secteur agricole de l’UE, qui a les meilleures cartes en main, et à quoi pourraient ressembler les résultats. Tout dépendra largement de la capacité de l’UE à rester unie et à mobiliser sa puissance pour protéger ses intérêts offensifs, en particulier dans le secteur agroalimentaire, déjà confronté à un manque de compétitivité et à des tensions avec la Chine.
LE RISQUE DE PERTE DE PARTS DE MARCHÉ POUR L’AGRICULTURE ET L’AGROALIMENTAIRE EUROPÉENS
L’UE bénéficie depuis longtemps d’un excédent commercial agricole important avec les États-Unis. En 2023, elle a exporté pour 27 180 millions d’euros et importé pour 11 744 millions d’euros, soit un excédent de 15 436 millions d’euros.
Les États-Unis sont notre deuxième marché d’exportation après le Royaume-Uni, représentant 12 % de nos exportations.
Une analyse plus approfondie de la composition du commerce UE-États-Unis montre que l’UE exporte principalement des produits transformés, tandis qu’elle importe surtout des matières premières.
D’après les dernières données de 2024, parmi nos principales exportations figurent :
- Vins (4 894 millions d’euros)
- Spiritueux (2 890 millions d’euros)
- Huile d’olive (2 056 millions d’euros)
- Fromages (1 306 millions d’euros)
D’autres produits tels que la bière, le chocolat, les pâtes, les jambons, le beurre et diverses préparations alimentaires dépassent également la centaine de millions d’euros d’exportations annuelles.
Du côté des États-Unis, les principales exportations vers l’UE sont :
- Soja (2 588 millions d’euros)
- Fruits et noix (2 200 millions d’euros)
- Spiritueux (1 076 millions d’euros)
Cette disparité entre la nature de nos exportations et importations soulève une question cruciale.
Les États-Unis peuvent facilement trouver d’autres débouchés pour leurs exportations de soja en cas de blocage en Europe. Le soja étant une matière première, si nous cessons d’importer des États-Unis au profit de l’Amérique du Sud, d’autres marchés absorberont aisément le soja américain en remplacement.
En revanche, les exportations de vin de l’UE ne peuvent pas être aussi facilement redirigées vers d’autres marchés. Les spécificités commerciales et marketing du vin rendent impossible la compensation des milliards perdus aux États-Unis par une simple augmentation des ventes ailleurs. L’UE pourrait augmenter sa part de marché sur d’autres marchés, mais au prix d’une baisse des prix et des marges.
Le même raisonnement s’applique aux exportations européennes de fromages, de jambons et d’huile d’olive.
Si l’UE perd le marché américain pour ses fromages et jambons de qualité supérieure, il lui sera presque impossible de trouver des marchés de substitution ou d’augmenter sa présence sur les marchés existants.
Le cas est encore plus flagrant pour l’huile d’olive : l’UE est de loin le premier producteur mondial avec peu de concurrents, ce qui signifie qu’il n’existe que peu d’opportunités pour évincer d’autres acteurs. De plus, il est quasiment impossible de remplacer les autres huiles alimentaires sur le marché, car les prix et les habitudes alimentaires sont des obstacles majeurs.
On pourrait faire des arguments similaires pour d’autres produits transformés à forte valeur ajoutée.
Principaux enseignements de cette analyse :
- L’UE, qui jouit d’un important excédent commercial agroalimentaire avec les États-Unis, a potentiellement plus à perdre dans ce secteur en cas d’escalade.
- Les exportations agroalimentaires européennes sont plus difficiles à rediriger vers d’autres marchés, ce qui amplifierait les pertes commerciales.
- Pour défendre ses intérêts offensifs, l’UE doit orienter ses représailles vers d’autres secteurs et exploiter les marchés de consommation où les grandes entreprises américaines (GAFAM) ne peuvent pas se permettre de perdre du terrain.
LES GUERRES COMMERCIALES FONT DES DÉGÂTS DES DEUX CÔTÉS
Une guerre commerciale entre les États-Unis et l’UE nuira aux deux parties. L’économie souffrira, les emplois aussi. Nous nous concentrerons cependant sur les conséquences pour l’UE.
L’ampleur des dégâts dépendra de l’ampleur du conflit, du nombre de produits concernés et des niveaux tarifaires appliqués.
Si les États-Unis ignorent totalement leurs obligations à l’OMC et imposent des droits de douane généralisés sur les importations européennes, l’impact sera considérable, et les États-Unis ne sortiront pas indemnes des représailles justifiées de l’UE. Les pertes économiques seront lourdes des deux côtés.
Toutefois, ce scénario n’est pas le plus probable. Il ne fait cependant aucun doute que les États-Unis appliqueront dans une certaine mesure leur nouvelle politique de réciprocité, imposant des droits de douane qu’ils jugent équivalents à ceux qu’ils subissent en Europe.
Il est clair que cela mettra en péril l’acquis du GATT et de l’OMC.
Le Président américain a déjà indiqué que toute riposte de l’UE entraînerait une surenchère, avec des contre-représailles pouvant aller jusqu’à des droits de douane de 200 % sur les vins. Jusqu’où cela ira-t-il ? Comment éviter une guerre commerciale qui dégénère sans fin ?
L’UE se considère comme un défenseur des règles de l’OMC et veut les faire respecter, alors que les États-Unis s’en détournent pour favoriser leurs intérêts nationaux avec une approche mercantiliste.
CONCLUSION
Les tensions initiées par les États-Unis sont particulièrement nuisibles au secteur agricole européen.
L’UE a plus à perdre qu’eux dans cette guerre commerciale, avec un excédent commercial agroalimentaire significatif et des produits difficilement redirigeables vers d’autres marchés.
Bien que les représailles de l’UE soient compréhensibles et justifiées, il est essentiel d’éviter une escalade dans l’agriculture et l’alimentation, qui inciterait les États-Unis à en faire de même.
Un accord négocié est dans l’intérêt du secteur. Si un tel accord est impossible, l’UE doit minimiser l’impact sur l’agriculture via des mesures de compensation économique et en ciblant d’autres secteurs.
L’UE défend un commerce mondial basé sur des règles, tandis que les États-Unis poursuivent une politique nationaliste de rééquilibrage du commerce.
À un moment où la coopération transatlantique est cruciale pour relever des défis mondiaux comme le changement climatique et la sécurité alimentaire, les négociateurs doivent trouver des solutions innovantes pour parvenir à un accord et éviter une guerre commerciale destructrice.