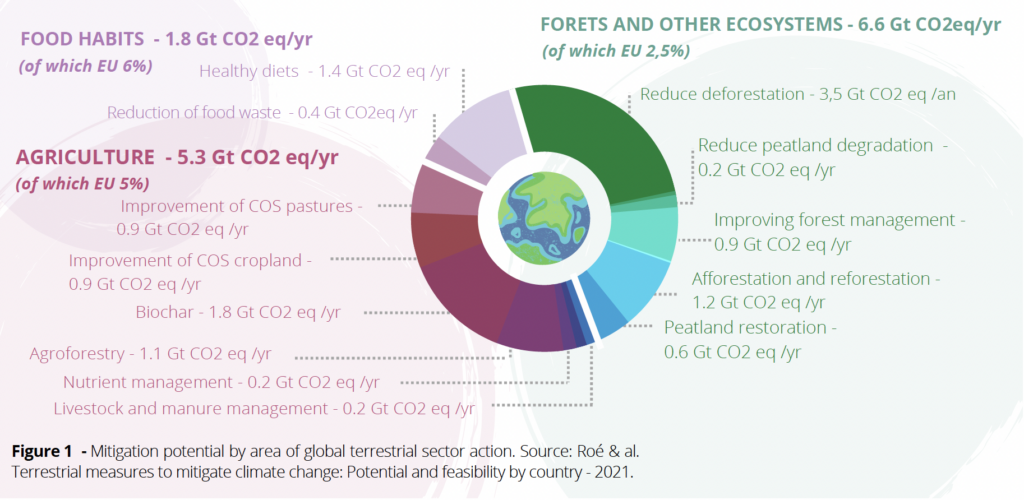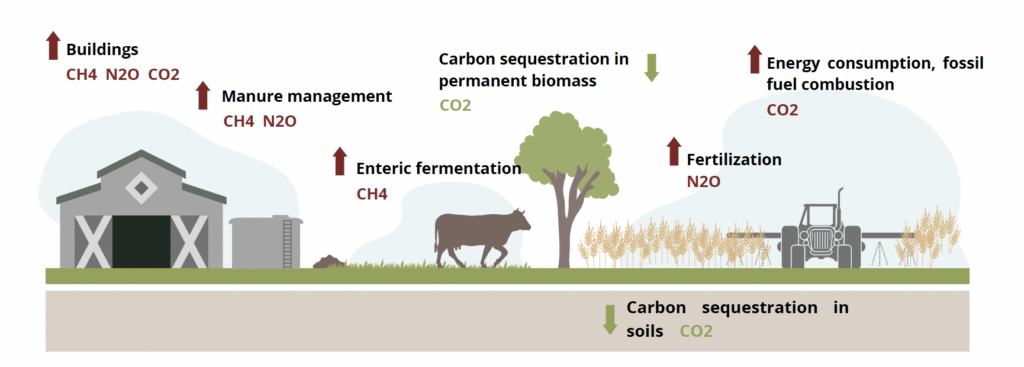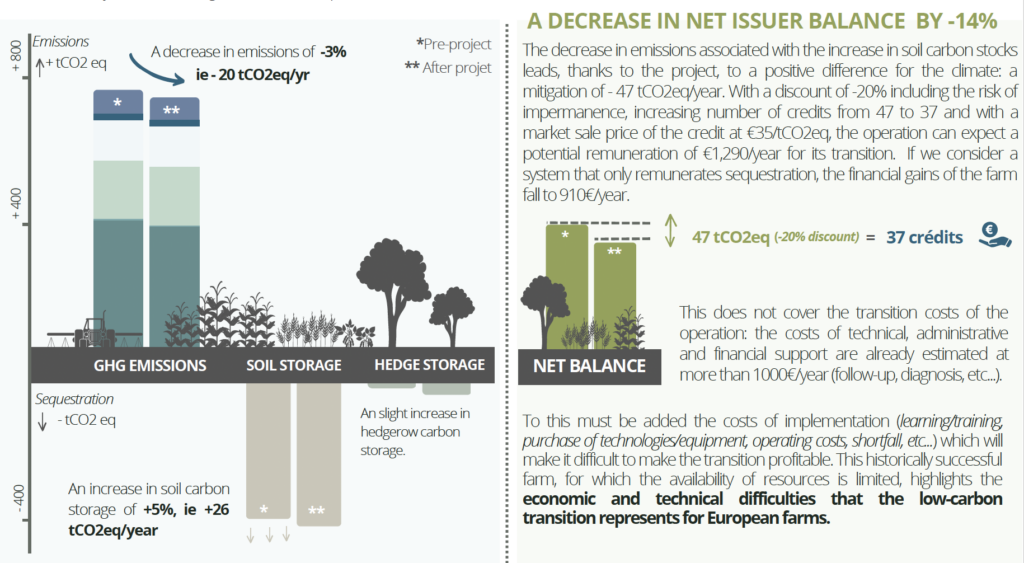🇪🇺 Une Europe à trois vitesses 🇪🇺
Depuis le début de la période budgétaire (2021), les États membres ont alloué plus de 18 milliards d’euros d’aides d’États au secteur agricole, ce qui représente pas moins de 11% des aides totales du 1er pilier de la PAC — une proportion qui monte à 14 % si l’on se concentre uniquement sur la période 2021-2023.
Les Pays-Bas ont de loin le plus soutenu leur agriculture, tant en montant absolu que relativement aux aides directes ou à la valeur de la production agricole nationale. Sur la période étudiée, les aides atteignent 101 % du premier pilier reçu par les agriculteurs néerlandais. Le Danemark, la Grèce, la Hongrie, la République Tchèque et la Slovaquie ont aussi octroyé des fonds substantiels, allant de 20 à 43% de leurs aides directes respectives. Sur la période 2021-2022, l’Espagne a distribué un équivalent de 28% de son premier pilier. Enfin, si les sommes totales distribuées par l’Italie, la France et l’Allemagne restent conséquentes, ces États ont limité leur soutien entre 5 et 10% de leurs aides directes respectives, soit un niveau inférieur à la moyenne européenne.
En moyenne européenne ces aides d’État n’ont compensé que partiellement (70%) la perte de la valeur réelle des aides du 1er pilier de la PAC découlant de leur non-indexation sur l’inflation. Toutefois, la situation varie considérablement d’un État membre à l’autre :
- Quatre pays ont surcompensé la baisse, apportant aux agriculteurs des liquidités pouvant dynamiser la capacité d’investissement. C’est le cas en particulier des Pays-Bas qui se démarquent nettement avec un soutien 8 fois supérieurs à la baisse liée à l’inflation. La Pologne et l’Espagne (1,4 fois), ainsi que la Grèce (1,3 fois), suivent.
- Les autres États ayant le plus soutenu leur agriculture ont compensé la baisse entre 50 et 75%.
- Enfin certains pays, rappelons-le, ont versé peu d’aide d’État à leur agriculture (Lettonie, Estonie, Irlande, Roumanie, Belgique, Luxembourg, Bulgarie et Portugal).
Remarque :
Il convient de souligner que le chiffre de 18 milliards d’euros reste minoré, les données disponibles présentant certaines limites :
- Seuils de publication : Les États membres ne sont tenus de référencer leurs aides qu’au-delà de certains seuils1, ce qui entraîne une sous-évaluation des montants réels dépensés.
- Les données pour 2024 ne comprennent que les aides référencées avant le 8 novembre. Ainsi, la proportion des aides par rapport aux aides PAC est sous-estimée.
- Absence de certaines données nationales : la Pologne, l’Espagne, la Roumanie et la Slovénie n’utilisent pas la base de données de la Commission, mais leurs propres registres nationaux de transparence. La Pologne et l’Espagne figurent parmi les pays qui ont subventionné de façon importante leur secteur agricole à travers les aides d’États. Notamment, selon le State Aid Scoreboard (l’instrument de référence de la Commission européenne pour le suivi des aides d’État), l’Espagne et la Pologne ont alloué respectivement 1,97 et 1,88 milliard d’euros, d’aides d’État à leurs agricultures sur la période 2021-2022.
Sommaire
Des aides hétérogènes entre les États membres
Les volumes d’aides accordés varient fortement entre les États membres. Trois groupes distincts se dessinent.
Dix pays ont accordé des volumes d’aides approchant ou dépassant largement le milliard d’euros. Ils totalisent à eux-seuls plus de 15,5 milliards d’euros. Si l’on regarde exclusivement les aides référencées dans la base de données de la Commission (hors Espagne et Pologne), les aides des huit premiers pays s’élèvent à 11,6 milliards d’euros, soit 84% des aides référencées. Parmi eux, les Pays-Bas se distinguent avec 2,83 Md d’euros d’aides, suivis de l’Italie, la France, le Danemark, l’Allemagne, la Grèce et la Hongrie, qui se situent tous entre 1 et 1,5 milliard d’euros2.
Un second groupe d’États se caractérise par des enveloppes d’aides qui restent conséquentes, mais qui sont néanmoins bien inférieures au premier. Slovaquie, Autriche, Lituanie, Suède, Lettonie, Finlande, Irlande et Croatie ont soutenu leur secteur agricole à hauteur d’une à quelques centaines de millions d’euros. Enfin, un dernier groupe d’États qui ont très peu ou pas utilisé ce dispositif d’aides, parmi lesquels la Bulgarie, le Portugal ou encore la Belgique.
L’analyse évolue si l’on compare les aides d’État aux montants des aides directes de la PAC :
- Les Pays-Bas ont de loin le plus soutenu leur agriculture, tant en montant absolu que relativement aux aides directes. Sur la période étudiée, les aides atteignent 101 % du premier pilier.
- Le Danemark, la Grèce, la Hongrie, la République Tchèque et la Slovaquie ont aussi octroyé des proportions très élevées, allant de 20 à 43% de leurs aides directes respectives. Sur la période 2021-2022, l’Espagne et la Pologne ont distribué chacune un équivalent de 28% et 17% de leurs aides du premier pilier.
- A contrario, si les sommes totales distribuées par l’Italie, la France et l’Allemagne restent conséquentes, ces États ont limité leur soutien entre 5 et 10% de leurs aides directes respectives, soit un niveau inférieur à la moyenne européenne.
Un soutien agricole inégalement proportionné à la valeur de la production
On retrouve également cette hétérogénéité quand on compare les aides versées à la valeur de la production agricole des différents pays sur la période 2021-2023.
Huit États ont accordé des montants particulièrement élevés en proportion de la valeur de leur production agricole (entre 2,5% et 4,5%), parmi lesquels : la Slovaquie (4,5%), suivie de la République Tchèque, la Hongrie et la Grèce (3% – 3,5%). Enfin, la Lettonie et les Pays-Bas se situent tous les deux autour de 2,5%.
Cinq États ont versé des proportions légèrement inférieures mais néanmoins substantielles de leur valeur agricole (entre 1 et 2%) : la Lituanie et la Pologne (2%), suivies de la Croatie, l’Estonie et l’Espagne (1%). Cette dernière est, parmi les États aux chiffres d’affaires agricoles les plus élevés, la seule à avoir subventionné dans de telles proportions.
Six États ont attribué des aides dans des proportions plus modérées, comprises entre 0,5% et 1% : L’Autriche, l’Italie, la Finlande et la Suède se situent légèrement en dessous de 1%, tandis que l’Allemagne et la France sont autour de 0,5 %.
Enfin, les huit derniers États ont alloué des proportions faibles à très faibles (< 0,5%), parmi lesquels : l’Irlande, la Roumanie et la Bulgarie sont autour de 0,3% alors que la Belgique, le Luxembourg et le Portugal ont versé moins de 0,1%.
Des aides qui ne compensent que partiellement l’érosion des aides PAC du fait de l’inflation
Dans la plupart des États, les aides sont inférieures à l’inflation cumulée sur la période 2021-2023. A l’échelle de l’UE, les aides d’États n’ont que partiellement compensé la perte de valeur réelle des aides du premier pilier, due à leur non-indexation sur l’inflation. Sur cette période, elles couvrent environ 70% de cette baisse. La situation varie toutefois d’un État membre à l’autre et l’on distingue 3 catégories parmi ceux ayant le plus soutenu leur agriculture :
Les Pays-Bas, qui se distinguent par un niveau d’aides d’État totalement atypique : le montant alloué est 7,8 fois supérieur à la perte de valeur réelle des aides du premier pilier.
Les États qui ont largement compensé la baisse :
- Espagne : a connu l’inflation la plus faible de l’Union européenne avec la France (12%). Ses aides représentent 142% de la baisse.
- Pologne : a enregistré une inflation relativement modérée, autour de la moyenne européenne (20%). Ses aides représentent 140% de la baisse.
- Grèce : Ses aides représentent 133% de la baisse. Avec les Pays-Bas, ce sont les deux seuls pays à avoir connu des inflations relativement modérées (inférieures à la moyenne européenne) mais à avoir alloué plus de 2,5% de la valeur de leur production agricole.
Ceux qui n’ont que partiellement compensé la baisse :
- République Tchèque : compensation à 91%. Bien que deuxième en termes de proportion d’aides par rapport à la valeur agricole, elle figure parmi les États membres les plus touchés par l’inflation entre 2021 et 2023 (32%) et ses aides n’ont pas suffi à entièrement compenser la perte de valeur des aides PAC.
- Hongrie : compensation à 61%. Malgré des aides élevées, tant en valeur absolue qu’en proportion de sa valeur agricole, la Hongrie a enregistré le taux d’inflation le plus élevé de l’Union européenne sur la période (41%), atteignant un niveau deux fois supérieur à la moyenne européenne.
- Italie : compensation à 75%.
- France : compensation à 50%.
- Allemagne : compensation à 47%.
La France, l’Allemagne et l’Italie sont de loin ceux dont la valeur agricole est la plus élevée. Entre 2021 et 2023, ils contribuent respectivement à 18% (274 Md €), 14% (216 Md €) et 13% (207 Md €) de la valeur de l’UE. Ce sont pourtant ces trois mêmes pays qui, parmi ceux ayant soutenu leur agriculture, ont alloué le moins proportionnellement à leur valeur agricole et qui ont le moins compensé la baisse des aides liée à l’inflation.
Parmi les autres États ayant versé des aides bien inférieures en valeur absolue, on distingue deux groupes.
Ceux dont les aides ont compensé une partie des pertes :
- Slovaquie : compensation à 95%. Sa situation est similaire à celle de la République Tchèque. La Slovaquie est l’Etat membre qui a le plus versé d’aides en proportion à sa valeur agricole (4,5%), mais elle figure aussi parmi ceux les plus frappés par l’inflation (29%). Si ses aides ont permis de compenser les pertes, elles n’ont pas suffi à renforcer la capacité d’investissement de ses agriculteurs.
- Autriche : compensation à 65%.
- Finlande, Croatie, Lituanie et Suède : compensation entre 40 et 45%. La Croatie et la Lituanie se distinguent par des proportions élevées d’aides par rapport à leur valeur agricole (autour de 1,5%), tandis que la Finlande et la Suède, moins affectées par l’inflation, ont alloué des proportions plus modérées (autour de 0,7%).
Ceux qui ont très peu ou pas compensé les pertes :
- Lettonie (compensation à 32%) et Estonie (22%) se distinguent par des aides élevées en proportion de leur valeur agricole, respectivement 2,7 % et 1,1 %. Cependant, ces deux pays ont également subi des inflations parmi les plus fortes de l’Union européenne (32% et 36% respectivement).
- Roumanie (compensation à 16%) et Bulgarie (1%) : bien qu’ayant enregistré des inflations relativement fortes, autour de 30%, elles ont versé des aides en proportions très faibles.
- Irlande (compensation à 18%), Belgique (12%), Luxembourg (8%), et Portugal (0%). Ces derniers États n’ont que très faiblement compensé les pertes, malgré des inflations relativement faibles (autour de 15%).
Catégories d’aides
Les aides d’États notifiées comme « réponses à des crises » dominent largement, puisqu’elles comptent pour 74% du total des aides distribuées par les États Membres.
Les aides relatives au COVID-19 représentent le premier pôle de dépenses des aides d’État au secteur agricole. Elles comptent pour 6 Md € ou 43% du total des aides sur la période, une part supérieure à toutes les autres aides de crises confondues (31%). Bien que des aides COVID continuent à être distribuées en 2024, elles sont allées decrescendo depuis 2021 et ont connu une forte réduction en 2023. Les États ayant le plus distribué d’aides en réponse au COVID-19 sont le Danemark (1,27 Md €), les Pays-Bas (1,25 Md €), la Grèce (1,10 Md €) et, dans une moindre mesure, l’Italie (781 M €), l’Allemagne (431 M €) et la Hongrie (399 M €). Pour les trois premiers pays, les aides COVID seules ont représenté 39%, 45% et 13% de leurs aides directes, respectivement.
En parallèle, les aides sous le cadre TCF (Temporary Crisis Framework) comptent pour 1,26 Md € ou 9,1% des aides totales versées sur la période. Elles ont avoisiné le milliard en 2023, année durant laquelle elles ont été la 1ère source d’aides de crise, en comptant pour 23% des aides totales. L’Italie (475 Md €) et la Hongrie (311 Md €) dominent largement dans l’utilisation du cadre TCF, suivies par la France (130 M €) et la Slovaquie (101 M €). A eux seuls, ces 4 États Membres comptent pour 81% de cette catégorie d’aide.
Les aides TCTF (Temporary Crisis and Transition Framework) s’élèvent à 641 millions d’euros. Débutées en 2023, ces aides pèsent moins dans le total sur la période. Toutefois, bien que l’ensemble des aides ne soient pas encore référencées, les aides TCTF semblent être le premier pôle d’aides en 2024 (33%), faisant suite à celles COVID les années précédentes. C’est la Slovaquie qui domine largement les aides TCTF, avec 342 M €. La France (123 M €) et les Pays-Bas (99 M €) suivent de façon plus mesurée, alors que le reste des États membres n’ont que peu ou pas versé d’aides sous ce cadre.
Les aides à la prévention, au contrôle et à l’indemnisation des maladies animales et végétales atteignent 1,1 Md € et comptent pour 8% du total des aides, soit légèrement moins que les aides du cadre TCF. Leurs volumes ont augmenté de 193% entre 2021 et 2023,. Le secteur de l’élevage compte pour la grande majorité de ces aides (85%). La France (503 M €) représente à elle seule quasiment la moitié de ces aides, suivies de la République Tchèque (219 M €) et de la Suède (121 M €).
Les aides liées à des événements climatiques ou naturels, enfin, s’élèvent à 777 millions d’euros. Si elles restent minoritaires dans le mix d’aides, elles ont augmenté de 124% entre 2021 et 2023. Ces aides ont concerné essentiellement la France (315 M €), l’Italie (235 M €) et la Hongrie (117 M €), qui comptent à elles seules pour 86% de ces aides. D’autres pays aussi très touchés par de tels phénomènes, comme la Grèce ou le Portugal notamment, n’ont pas octroyé ces aides.
Les aides hors crise, elles, comptent pour 3,6 Md € ou 26% du total des aides. Les Pays-Bas (1,14 Md €), l’Allemagne (737 M €) et la République Tchèque (530 M €) ont distribué des montants largement supérieurs aux autres pays et représentent à eux trois 66 % de ce type d’aide. Poussées par ces 3 pays, les aides hors crise ont augmenté de 77% entre 2021 et 2023.
Secteurs soutenus
Bien que les secteurs bénéficiant des aides États ne soient pas toujours spécifiés, ce qui limite l’analyse, certains traits apparaissent de façon évidente.
Tous États confondus, le secteur de l’élevage a bénéficié le plus d’aides, à hauteur de 5,27 Md € ou 38% des aides.
En termes de montants absolus, les États ayant le plus soutenu leur élevage sont le Danemark (1,26 Md €), les Pays-Bas (865 M €), la France (647 M €), la Grèce (583 M €) et, dans une moindre mesure, la Hongrie (427 M €), la République Tchèque (386 M €), et l’Allemagne (372 M €).
Si l’on regarde la proportion de l’élevage dans l’ensemble des aides de chaque État, il apparaît que le Danemark (93%), la Finlande (84%), la Suède (67%), l’Estonie (63%), l’Irlande (54%), la Lituanie (51%), la Grèce (47%) et la France (44%) ont soutenu le secteur de façon spécifique.
L’Italie (75%), l’Autriche (63%) et la Hongrie (44%) ont, elles, plus soutenu leur secteur de la production végétale.
Analyse des États les plus « généreux »
🇳🇱 Pays Bas :
Les Pays-Bas ont de loin le plus soutenu leur agriculture, à la fois en montant absolu que relatif aux aides directes. Sur la période étudiée, les aides d’États allouées sont supérieures aux aides directes de la PAC.
Les Pays-Bas se distinguent par un soutien fort hors et pendant les crises. Leurs aides hors crise, notamment liées au plan national de transition agricole, représentent une part significativement plus importante de leurs aides que le reste des États Membres (40% contre 26% en moyenne dans l’UE). Elles comptent à elles seules pour 1,14 Md d’euros, soit 41% des aides directes du pays, et plus ou quasiment autant que les aides moyennes des autres États, toutes catégories confondues. En parallèle, les Pays-Bas ont aussi massivement distribué des aides en réponse au COVID-19, à hauteur de 1,25 Md d’euros. En comparaison, cela équivaut à ce que les 7 autres États ayant distribué des montants d’aides importants ont versé en moyenne, toutes aides confondues.
Les aides ont été distribuées de façon relativement homogène entre les différents secteurs.
🇮🇹 Italie :
Catégories : Par rapport à la moyenne européenne, l’Italie a versé des proportions plus élevées
- d’aides COVID : 50% (781 M €) contre 43%
- d’aides TCF : 31% (475 M €) contre 9%.
- d’aides liées à des événements climatiques ou naturels : 15% (235 M €) contre 8%.
A l’inverse, elle n’a versé aucune aide à la prévention, au contrôle et à l’indemnisation des maladies animales et végétales.
Secteurs : L’Italie se distingue par un soutien fort à la production végétale (l’analyse des sous-secteurs est moins claire et ne laisse pas apparaître de soutien axé prioritairement au secteur viticole). Ce “focus” végétal est d’autant plus marqué pour les aides COVID (87%) et TCF (93%).
🇩🇪 Allemagne :
Catégories : l’Allemagne a distribué majoritairement des aides hors crise (57%), et se distingue par un soutien durant les crises moindre, comparée aux autres “gros distributeurs” d’aides. A l’exception des aides COVID, qui représentent quand même 431 M d’euros, l’Allemagne a assez peu octroyé d’aides de crise.
Secteurs : le pays se caractérise par un soutien relativement homogène à tous les secteurs et par un soutien marqué à la polyculture-élevage (mixed farming) qui comptent pour 17% (219 M €) de ses aides, contre 4% en moyenne dans l’UE.
🇫🇷 France :
Catégories : les proportion et montant sont plus faibles s’agissant des aides COVID (14% ou 200 M €), comparés à la moyenne européenne (43%) et aux autres États ayant distribué des montants d’aides importants (764 M €). Les aides à la prévention, au contrôle et à l’indemnisation des maladies animales et végétales occupent une place importante : 34% (503 M €) des aides sur la période. En 2023 et 2024, ces aides sont le premier pôle de dépense. Les aides liées à des événements climatiques ou naturels sont elles aussi supérieures à la moyenne européenne et aux autres États ayant distribué des montants d’aides importants : elles comptent pour 22% des aides (315 M €) dans le cas français. Ces aides ont été particulièrement fortes en 2022 (53% du total de ces aides).
Secteurs : Similairement à son voisin allemand, la France se caractérise par un soutien relativement homogène à tous les secteurs, avec toutefois une proportion des montants légèrement supérieure pour le secteur de l’élevage par rapport aux autres. Au sein de l’élevage, ce sont les élevages porcins (majoritairement en lien avec un soutien suite à la crise du COVID-19) et le secteur de la volaille (en lien avec des maladies) qui dominent. Pour les aides liées à des événements climatiques ou naturels, celles-ci ont notamment visé les fruitiers et la vigne.
🇩🇰 Danemark :
Le cas du Danemark est spécifique car bien qu’il apparaisse parmi ceux ayant fortement soutenu leur agriculture, ce soutien ne concerne en fait quasiment que le secteur de l’élevage de visons. En effet, les aides du Danemark sont à 93% liées au COVID-19 et à 86% à destination du sous-secteur “other animals”. Les aides à ce sous-secteur sont à 96% des aides pour les élevages de vison, suite à la décision d’abattre l’ensemble des visons en 2020. Mis à part ces aides, les aides danoises sont faibles : elles s’élèvent à environ 186 millions d’euros dont 83 M à l’élevage porcin.
🇬🇷 Grèce :
Catégories : Les aides COVID représentent la grande majorité des aides distribuées par la Grèce : 88% des aides du pays, pour un total de 1,10 Md d’euros. Les aides grecques se concentrent principalement en 2021 et 2022. La Grèce a distribué très peu d’autres aides de crise et notamment quasiment pas liées à des événements climatiques ou naturels.
Secteurs : le secteur porcin reçoit à lui seul 44% des aides (555 M €), une concentration d’autant plus forte si l’on ne regarde que les aides COVID (50%).
🇭🇺 Hongrie :
Catégories : proportion et montant légèrement plus faibles d’aides COVID (38% ou 399 M €), comparés à la moyenne européenne (43%) et aux autres États ayant distribué des montants d’aides importants (764 M €). A l’inverse, proportion et montant relativement élevés d’aides TCF (30% ou 311 M d’euros). Par ailleurs, au côté de la France et de l’Italie, la Hongrie fait partie des trois États à avoir significativement alloué des aides liées à des événements climatiques ou naturels. Celles-ci comptent pour 11% ou 117 M d’euros dans le cas hongrois.
Secteurs : la Hongrie a soutenu de façon très homogène les secteurs de production végétale et ceux de l’élevage. Elle se distingue notamment par un soutien net à la production de céréales, légumineuses et oléagineux qui reçoit 32% (328 M €) des aides totales. Cette homogénéité se retrouve au sein du secteur de l’élevage : 14% pour la volaille, 13% pour le porc et 7% pour les vaches laitières.
-
-
- ↑ Aides d’État AGRI et ABER (Règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 et lignes directrices AGRI relatives aux aides d’État) :
Pour les aides après décembre 2022, les seuils d’obligation de transparence sont de 10 000 euros pour les bénéficiaires actifs dans la production agricole primaire et de 100 000 euros pour les bénéficiaires dans les secteurs de la transformation des produits agricoles, de la commercialisation des produits agricoles, du secteur forestier ou pour les activités n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 42 du traité. Pour les aides avant décembre 2022, les seuils sont de 60 000 EUR pour les bénéficiaires actifs dans la production agricole primaire et de 500 000 EUR pour les bénéficiaires dans les secteurs de la transformation des produits agricoles, de la commercialisation des produits agricoles, du secteur forestier ou pour les activités ne relevant pas du champ d’application de l’article 42 du traité.
RGEC (Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié) : les seuils de transparence depuis juillet 2023 sont de 10 000 euros pour les bénéficiaires actifs dans la production agricole primaire, 100 000 euros pour les aides individuelles et 500 000 euros pour les aides impliquées dans des produits financiers soutenus par le fonds InvestEU. Pour les aides octroyées avant juillet 2023, le seuil est de 500 000 euros.
- ↑Italie : 1,55 Md € ; France : 1,46 Md € ; Danemark : 1,36 Md € ; Allemagne : 1,30 Md € ; Grèce : 1,25 Md € ; Hongrie : 1,04 Md €.